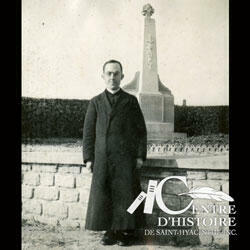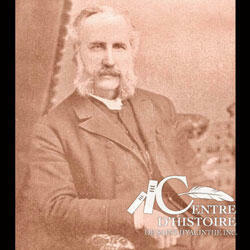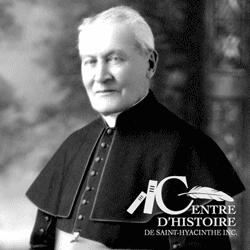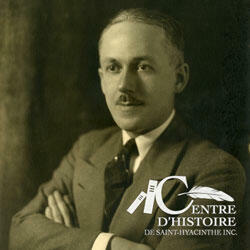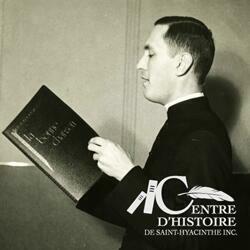Ce fonds témoigne de tout un pan de l'histoire sociale de grandes familles de Saint-Hyacinthe, Montréal, Saint-Denis, Saint-Ours et Ottawa. Constitué en grande partie d’une riche correspondance entre plusieurs générations d’individus liés de près ou de loin aux familles Laframboise et Dessaulles, Saint-Jean et Larue, mais aussi Blondeau, Côté, Fréchette, LaMothe, Loranger, Malhiot et Papineau, on y discute de vie privée ou publique, de familles ou d’affaires, et cela de la fin du 18e au début du 20e siècle. On retrouve aussi de la documentation sur la vie personnelle et professionnelle de Louis Laframboise, dont ses études, son voyage en Europe, ses recherches généalogiques, ses relations amicales, son implication au sein du journal Le National, ainsi que sa carrière dans la fonction publique fédérale. Un grand album souvenir, probablement créé par Alphonsine Saint-Jean, regroupe de nombreux documents anciens, coupés et collés à l’intérieur de l’album, ainsi que plusieurs photographies des années 1890 qui sont également collées et malheureusement non identifiées, quoique l’on puisse figurer l’identité de certains personnages. Les photographies comprennent également des portraits d’Emma Beaudry, qui devait épouser Louis Laframboise, ainsi que Georges-Casimir Dessaulles lors de l’inauguration de la Porte des anciens maires en 1927, le Dr Pierre Saint-Jean et le couple Lévi Larue et Nophlette Brazeau, grands-parents d’Alphonsine Saint-Jean. Les objets sont des cheveux gardés en souvenir par Alphonsine.
Famille Louis LaframboiseEurope
14 Description archivistique résultats pour Europe
Ce fonds témoigne des activités et de diverses périodes de vie de l’Abbé Lefebvre, notamment son internement de juillet 1940 à août 1944, durant la deuxième guerre mondiale. Aussi, plusieurs documents étayent de ses relations avec sa sœur, Antoinette Lefebvre, ainsi que de ses occupations religieuses.
Ce fonds comprend un cahier manuscrit et un album de photographies datant de l’internement de l’Abbé Lefebvre, un second album de photographies, divers certificats, avis de décès, documents funéraires, un album souvenirs, des objets ; tels que des crucifix, un chapelet, des médailles, un brassard, de la documentation, des coupures de journaux, un carnet d’adresses, des reçus, des factures, des notes manuscrites, un agenda scolaire, une carte géographique de Paris, de la correspondance, des listes d’effets personnels. Certaines lettres portent le sceau avec l’inscription allemande « GEPRÜFT » ou d’autres estampes et sceaux en anglais et en allemand. Aussi, nous retrouvons un document manuscrits portant la mention « Les mémoires d’un interné », où il est possible d’y lire l’historique des évènements qui ont eu lieu durant les années d’emprisonnement, le tout a d’ailleurs été retranscrit, possiblement par Antoinette, dans un cahier.
abbé Pierre-Hugues LefebvreCe fonds témoigne de la multitude de responsabilités et de dossiers qui intéressent Émile Chartier à tout ce qui touche la littérature, la religion, les langues et surtout la jeunesse qui a besoin d’être éduquée pour former une société forte et instruite. Émile Chartier établit des contacts partout où il passe et communique avec plusieurs personnalités importantes de la société canadienne. D’ailleurs, la volumineuse correspondance que contient ce fonds d’archives témoigne de la vitalité de ses relations, mais également de son intérêt pour garder les traces tangibles des conversations puisqu’il demande à ses destinataires de conserver leur correspondance, ce qui aura comme résultante que dans certains cas, le fonds contient autant la correspondance reçue que celle qu’il avait envoyée à ses interlocuteurs. On retrouve des échanges avec plusieurs membres de sa famille dont son père Étienne Chartier, son oncle l’abbé Victor Chartier; des amis et collègues de classe; de nombreux échanges de correspondance durant son séjour d’études de quatre ans en Europe; ses confrères de travail et ses anciens élèves au Séminaire de Saint-Hyacinthe; ses confrères de travail, ses anciens élèves et ses nombreux contacts durant sa longue carrière à l’Université Laval puis à l’Université de Montréal dont Mgr Paul Bruchési; et des personnages-clés de son implication sociale et littéraire, tels l’abbé Lionel Groulx, Olivar Asselin et Jules-Paul Tardivel. On trouve aussi des dossiers de recherches personnelles, dont un dossier sur l’abbé Étienne Chartier; des sermons; des dossiers sur ses implications sociales, telles l’Association catholique pour la jeunesse canadienne-française et la Société royale du Canada, ainsi que de nombreux autres organismes à caractère social et éducationnel; les textes des nombreuses conférences données par Émile Chartier durant sa carrière à l’Université de Montréal, touchant surtout des sujets à caractère social, tels la religion, l’éducation, les relations de travail et particulièrement sur les relations entre francophones et anglophones du Québec et de l’Ontario et sur les méthodes d’enseignement. Finalement, on retrouve des dossiers relatifs à sa production littéraire, soit une dizaine de monographies; également comme directeur de revue, collaborateur journalistique; compositeur (chansons et poésies); et des collaborations à des encyclopédies et à titre de réviseur. Les photographies nous montrent Émile Chartier dans différentes circonstances, lors de ses voyages en Europe, en compagnie de collègues dont Mgr Paul Bruchési à LaFlèche et le Père Jérôme en Angleterre, ainsi que des membres de la famille Chartier, dont les frères Jean-Baptiste, Victor et Ferrier. Les documents iconographiques sont composés de cartes postales envoyées et reçues par Émile Chartier, dont plusieurs d’Europe, mais également une collection d’images de la Première Guerre mondiale.
Mgr Émile ChartierLe fonds témoigne de l’importance de l’homme militaire que fut le docteur Albéric Morin, puisque ses funérailles, célébrées le 21 décembre 1960, ont mobilisé les troupes militaires durant toute la cérémonie, de Montréal à Saint-Pie. Le don comprend des négatifs de la journée des funérailles du docteur Marin, où on le voit dans son cercueil avec deux vigiles militaires, puis à la sortie du cercueil, enveloppé du drapeau britannique, de l’hôpital Notre-Dame, et le long du convoi jusqu’à la Basilique Notre-Dame. On voit ensuite le cortège à la sortie de la Basilique, puis arrivant à l’église de Saint-Pie. Finalement, une émouvante cérémonie militaire du «Dernier repos» se déroulera au cimetière de Saint-Pie, du tir de fusils à l’hommage musical. Toutes les images ont été prises par René Bausset.
Dr Albéric MarinCe fonds témoigne d’une parcelle de la vie de Rieul-Prisque Duclos, à l’époque où il est étudiant à Genève, stagiaire à Edinburgh et pasteur en Europe et au Québec. On retrouve surtout de la correspondance qui avait été probablement conservée précieusement par Sophie Jeanrenaud, composée de lettres de Rieul Duclos à différentes époques, des membres de la famille Jeanrenaud, quelques correspondances de leurs fils Arnold et Charles, ainsi que de la correspondance entre Rieul Duclos et Philippe Wolff lors de la controverse à propos du pasteur Emmanuel Tanner, et des lettres de candidats à un poste de professeur au sein de l’école dissidente que constituait le pensionnat de jeunes filles à Saint-Hyacinthe. On retrouve également un exemplaire original en deux volumes de L’Histoire du protestantisme français au Canada et aux États-Unis par Rieul-Prisque Duclos, paru en 1913, peu de temps après son décès. Finalement, le fonds contient la documentation relative à la découverte de ces précieux documents par Me Guy Morin dans la maison ancestrale des Duclos à Saint-Pie en 1948.
pasteur Rieul-Prisque DuclosCe fonds est divisé en trois séries qui témoignent de la vie politique et personnelle d’Huguette Corbeil. La première série comprend des documents liés à son implication dans le monde politique municipal et fédéral, comme des coupures de presse, des dépliants de candidats, des rapports de dépenses électorales, des déclarations de candidature, des listes électorales, de la correspondance, des programmes électoraux, un plan marketing et des dossiers de recherches. La seconde série contient des documents liés aux implications sociales d’Huguette Corbeil dans différentes organisations de la région, dont la Fêtes du 50e de la paroisse du Sacré-Cœur-de-Jésus, les Jeux du Québec tenus à Saint-Hyacinthe et Secondaire en spectacle – Rendez-vous panquébécois Montérégie. La série comprend des communiqués et des coupures de presse, des dépliants promotionnels, des photographies, des discours, de la correspondance, des programmes, des bulletins d’information et des rapports financiers. La troisième série porte sur la vie personnelle d’Huguette Corbeil et concerne sa famille, notamment un dossier sur ses parents Émile Corbeil et Jeannette Guertin et un autre sur l’organisation entourant les célébrations des 45e et 50e anniversaires sacerdotaux de son frère Jean Corbeil, et ses voyages effectués avec son conjoint Pierre Solis. Cette série contient un album souvenir, des faire-part, des lettres de félicitations, des signets mortuaires, des discours, des comptes rendus, des procès-verbaux et des ordres du jour de réunions, des listes d’invités, des photographies, des rapports financiers, des formulaires d’inscription, de la correspondance, des programmes d’activités, un journal de voyage, des cartes postales, des billets et des factures.
Huguette CorbeilCe fonds offre un témoignage indéniable de la vie tumultueuse de Jérôme-Adolphe Chicoyne qui, de 1868 à 1910, sera tour à tour avocat, colonisateur, journaliste et rédacteur en chef, puis maire de trois municipalités dont la ville de Sherbrooke, où il s’est établi, et enfin député de Wolfe. À ce dernier titre, il s’impliquera dans plusieurs dossiers importants, soit l’agriculture, la colonisation, l’enseignement et les tribunaux, et plusieurs projets de lois dont ceux de la conciliation, de la protection du colon et du bien de famille (homestead) et la réforme des tribunaux judiciaires. Jérôme-Adolphe Chicoyne a été un des précurseurs du mouvement coopératif grâce à son expérience de colonisateur, constamment au fait de la situation précaire des colons et souhaitant le développement d’un territoire magnifique que constitue les Cantons de l’Est. Il saura utiliser ses ressources journalistiques pour passer ses messages, en sachant reconnaître ce que la loi lui permet. Par contre, son aventure avec le groupe de Nantais et les Pères Trappistes sera catastrophique. Le fonds contient des documents représentatifs de ces différentes expériences dont une volumineuse correspondance avec sa famille, ses amis et collègues de travail, dont Olivar Asselin, L.B. Bélanger, Henri Bourassa, L.O. David, Oscar Dunn, Ferdinand Gagnon, Honoré Mercier, Benjamin Sulte, Jules-Paul Tardivel, l’abbé François Tétreau, Pierre Vaillant et Gustave Vekeman. Ses voyages en Europe l’amèneront à se questionner sur ses origines et à établir des contacts avec les Chicoine de la France, permettant de constituer un dossier généalogique intéressant. On retrouve de la documentation sur son expérience d’avocat et de colonisateur, ainsi que de nombreux dossiers journalistiques contenant ses écrits et traitant différents sujets qui le préoccupent, surtout en ce qui a trait à la politique. Son expérience politique est documentée par des notes personnelles et plusieurs documents officiels publiés par le gouvernement, dont les projets de lois sur lesquels il a travaillé. Finalement, le fonds regroupe des articles biographiques dont quelques-uns sur le rôle de J.A. Chicoyne dans le développement du mouvement coopératif au Québec.
Jérôme-Adolphe ChicoyneCe fonds témoigne de la rigueur scientifique et du professionnalisme de l’abbé Isaac-Stanislas Désaulniers en ce qui a trait non seulement à sa vocation religieuse mais à sa capacité de transmettre son savoir philosophique autant aux élèves du Séminaire de Saint-Hyacinthe qu’à travers ses sermons et les conférences qu’il a effectués à Montréal. Son excellente réputation l’amène à effectuer un voyage à travers l’Europe et le Proche-Orient avec un de ses anciens élèves (et futur politicien renommé) Louis-Rodrigue Masson, aux frais de ses parents. Sa conviction religieuse l’a mené jusqu’en Illinois où Mgr Ignace Bourget, évêque de Montréal, l’envoie afin de «redresser les torts» de l’abbé Charles Chiniquy. Il sera si efficace à convaincre la population de ne pas suivre cet homme que Bourget ferme le dossier sans pour autant permettre à Désaulniers de revenir au Québec. Ce dernier devra demander l’intervention de Mgr Joseph-Sabin Raymond, alors Grand Vicaire du diocèse de Saint-Hyacinthe, pour qu’il puisse revenir et continuer ses mandats de professeur de philosophie et de supérieur au Séminaire de Saint-Hyacinthe. Le fonds regroupe donc quelques documents personnels, dont une correspondance avec son frère François Désaulniers, professeur au Séminaire de Nicolet, une volumineuse documentation sur la religion comprenant des transcriptions du latin au français de plusieurs documents religieux importants, comprenant les épitres de saint Paul et l’évangile de saint Mathieu, le catéchisme, l’œuvre de Melchior Cano et un des textes les plus marquants pour Désaulniers : La Somme contre les gentils de saint Thomas d’Aquin, ainsi que deux dossiers concernant l’implication de Désaulniers dans la controverse créée par Charles Chiniquy et, dans une moindre mesure, Louis-Antoine Dessaulles. On trouve aussi une importante documentation sur le contenu des cours de philosophie, de théologie et de sciences donnés par l’abbé Isaac Désaulniers, à travers l’écriture de ses élèves qui ont conservé leurs notes. On trouve même les notes de cours de Jérôme-Adolphe Chicoyne, futur journaliste et politicien. Une série regroupe la documentation sur le voyage en Europe de 1852-1854 et surtout, les intéressants carnets de voyage écrits par Désaulniers et détaillant tout le chemin parcouru à partir de l’Angleterre jusqu’à l’Allemagne en passant par l’Égypte, tandis qu’une autre série nous présente plusieurs textes manuscrits comprenant les conférences, discours, allocutions et analyses de Désaulniers. Finalement, on retrouve des publications sur l’abbé Isaac-Stanislas Désaulniers sous la plume de Louis-Olivier David, les abbés Émile Chartier et Lucien Beauregard, ainsi que le professeur Yvan Lamonde.
abbé Isaac-Stanislas DésaulniersCe fonds témoigne de l’important héritage spirituel et littéraire de cet homme qui a su naviguer à travers les vagues de l’avènement des nouvelles idées religieuses et philosophiques du XIXe siècle et son enseignement dans les écoles et la communauté civile. À travers sa volumineuse documentation écrite, il est possible de saisir comment la culture littéraire et les penseurs modernes du XIXe siècle ont confronté la pensée ultramontaine face au libéralisme. Le fonds permet de faire un tour d’horizon des écrits de Joseph-Sabin Raymond, à partir de ses premières années d’enseignement au Séminaire de Saint-Hyacinthe, où il crée plusieurs pièces de théâtre, dans ses nombreux sermons et écrits personnels sur la religion, à travers les dissertations et entretiens écrits par Raymond mais présentés par les élèves du Séminaire lors d’exercices d’éloquence, ainsi que par ses articles de journaux, ses conférences et ses discours dont plusieurs ont été publiés. Parmi les créations les plus importantes, notons le Discours sur l’éloquence, Nécessité de la religion dans l’éducation, Devoirs envers le Pape et Nécessité de la force morale. On retrouve de la correspondance avec Joseph La Rocque, son ami le plus précieux avec qui il aura des affinités jusqu’à la fin, quelques personnages illustres dont Chateaubriand, Montalembert, Lacordaire, les papes Pie IX et Léon XIII, et Louis-Joseph Papineau (au sujet de son fils Gustave). On trouve aussi des éloges et oraisons funèbres en l’honneur de plusieurs personnages importants, dont Denis-Benjamin Viger, le comte de Montalembert, Antoine Girouard, Isaac-Stanislas Désaulniers et Alexandre Taché, ainsi que des écrits sur la fondation de l’oeuvre des soeurs Adoratrices du Précieux-Sang, la béatification de Jean-Jacques Olier, le retour des zouaves pontificaux et la venue à Saint-Hyacinthe des frères Dominicains. Finalement, des dossiers contiennent une documentation intéressante sur la polémique entre Raymond et Louis-Antoine Dessaulles de l’Institut canadien de Saint-Hyacinthe, la polémique sur la question des études classiques chrétiennes et laïques ainsi que l’autorité du Pape. Les photographies nous présentent Joseph-Sabin Raymond durant les vingt dernières années de sa vie, tandis que les documents iconographiques sont des souvenirs pieux.
Mgr Joseph-Sabin RaymondCe fonds témoigne de l’évolution importante des sciences à la fin du XIXe et au début du XXe siècle et de l’intérêt prononcé que Mgr C.-P. Choquette démontrait pour ce domaine, soit la chimie, la physique, l’astronomie et l’électricité. Le fonds comprend de la correspondance, des coupures de presse, des notes manuscrites et dactylographiées, des manuscrits, des documents photographiques, des documents iconographiques, des coupures de presse, des livres et différents textes publiés par Mgr Choquette, ainsi que différents objets que Mgr C.-P. Choquette avait conservés en souvenir.
Mgr Charles-Philippe ChoquetteCe fonds témoigne de la vie sacerdotale du chanoine Jean-Baptiste-Arthur Allaire, de son intérêt pour l’histoire et l’agriculture et de son implication dans le mouvement du coopératisme agricole. Il comprend de la correspondance, des coupures de presse, des notes manuscrites et dactylographiées, des photographies, des ouvrages et articles écrits par le chanoine Allaire et publiés, des documents notariés, des cartes, des illustrations, des recensements, un journal, un mémoire, des reçus, des publicités, des brochures, un arbre généalogique et des formulaires complétés, des matrices d’imprimerie et des calendriers.
chanoine Jean-Baptiste-Arthur AllaireCe fonds témoigne de la vie d’un médecin dont la sensibilité s’exprime à travers l’art, dès ses années d’études au Séminaire de Saint-Hyacinthe. Suivant les traces de son père et de deux de ses frères (Jean et Jules), il pratique la médecine à Saint-Hyacinthe et particulièrement la chirurgie à l’ancien et au nouvel Hôpital Saint-Charles. Nommé coroner en 1937, il aura la lourde tâche d’enquêter sur l’incendie du Collège du Sacré-Cœur en janvier 1938, où 46 personnes ont perdu la vie, dont 41 enfants. L’année suivante, il démissionne de son poste et retourne à son premier mandat de médecin et chirurgien. À partir de 1957, il œuvre au sein de La Survivance compagnie d’assurance-vie et y demeurera durant plus de 25 ans. En parallèle, il développe son goût pour la peinture et s’illustre lors d’expositions à Saint-Hyacinthe et ailleurs au Canada, notamment au sein du Physician’s Art Salon où ses toiles sont primées et publiées dans des calendriers et une revue produite par The American Physicians Art Association. Apprécié par la population maskoutaine, il exposera à plusieurs reprises à Saint-Hyacinthe, non seulement dans sa clinique privée mais également au Séminaire de Saint-Hyacinthe et à l’Hôpital Honoré-Mercier. À partir des années 1940, il consacre ses vacances d’été à la pêche en louant un chalet (qu’il achètera plus tard), avec ses frères et sœurs, situé à Notre-Dame-de-Pontmain, près de Mont-Laurier. Le fonds contient surtout des documents personnels et financiers de Paul Morin ainsi que des témoignages de ses relations avec les membres de sa famille, y compris une intéressante documentation professionnelle de son grand-père maternel, le médecin Charles Lescault qui œuvra à Saint-Charles-sur-Richelieu durant le dernier tiers du XIXe siècle. Quelques documents nous permettent de mieux saisir la pratique médicale du Dr Paul Morin, notamment durant la courte période où il fut coroner. Une série sur les arts témoigne de son talent indéniable en dessin, notamment lors d’un exercice amusant de caricatures de ses confrères de classe de rhétorique, où on reconnaît le ténor Paul Dufault. On trouve aussi des croquis, dessins et des dossiers présentant les différentes expositions auxquelles il a participé. Finalement, on retrouve un touchant journal de vacances au chalet de Pontmain ainsi qu’un carnet des visiteurs, complétés au fil des années de fréquentation durant plus de 25 ans. Les nombreuses photographies nous permettent de voir les membres de la famille Morin qui ont gravité autour de Paul Morin durant son enfance à Saint-Jude jusqu’à la retraite à Saint-Hyacinthe et même au chalet de Pontmain, ainsi que des portraits des familles Lescault et Connell qui, malheureusement, ne sont pas toutes identifiées. On trouve aussi des photographies de la vie professionnelle du Dr Paul Morin, dont l’hôpital Saint-Charles de Saint-Hyacinthe et quelques événements mondains dans le cadre des activités de La Survivance. De plus, on retrouve quelques photographies des toiles de Paul Morin, peintre.
Ce fonds comprend de la correspondance, un journal de voyage, des papiers d'affaires et des actes notariés.
chanoine Magloire LaflammeCe fonds témoigne de la vie et des activités de l'abbé Gadbois. Il comprend de la correspondance personnelle, religieuse mais également un dossier étoffé sur la vie de l’entreprise La Bonne Chanson durant les années où Charles-Émile Gadbois en est l’instigateur et le Directeur. On retrouve également des notes de cours autant à titre d’élève que de professeur, des réflexions, des sermons, des diplômes, de la documentation religieuse et musicale, les publications imprimées de La Bonne Chanson, des programmes de concerts et de concours musicaux, de nombreuses partitions musicales dont les compositions de l’abbé Gadbois, des documents sonores et filmiques, des photographies et diapositives des séminaires de Saint-Hyacinthe et de Montréal, de confrères de classes, des nombreuses activités organisées à titre de Directeur de La Bonne Chanson, d'artistes et de voyages. Le fonds contient également une intéressante documentation sur les publications, recherches universitaires, conférences et expositions sur Charles-Émile Gadbois et La Bonne Chanson.
abbé Charles-Émile Gadbois