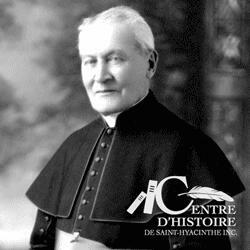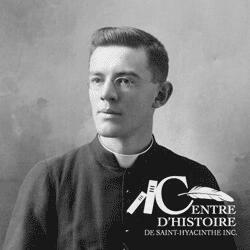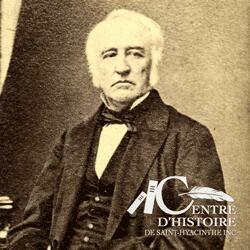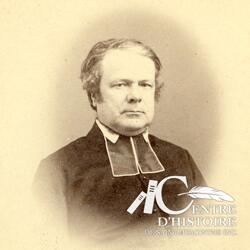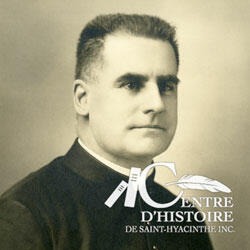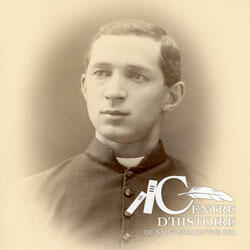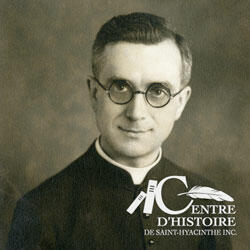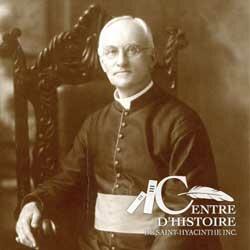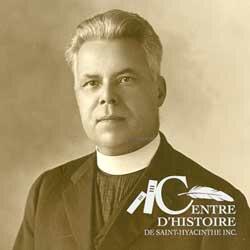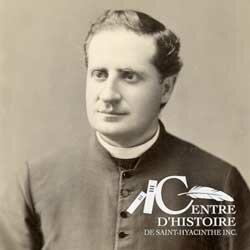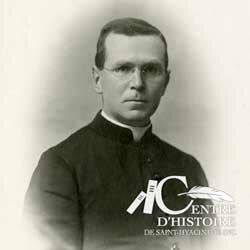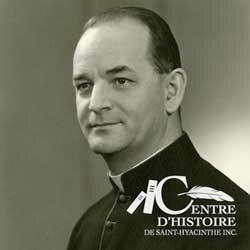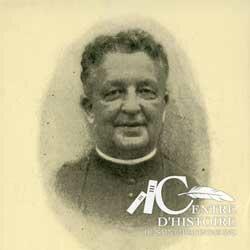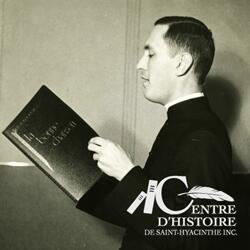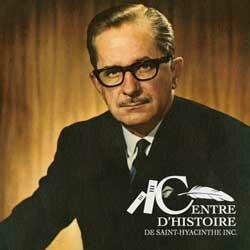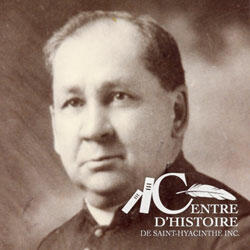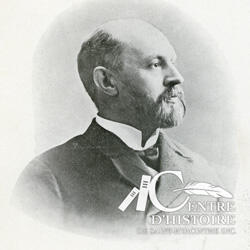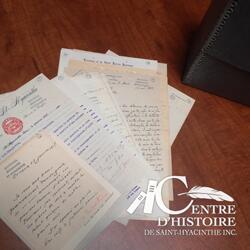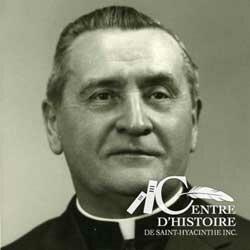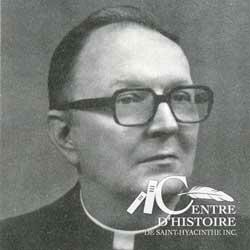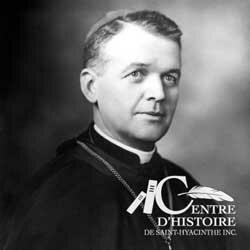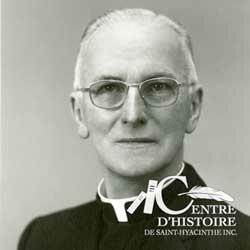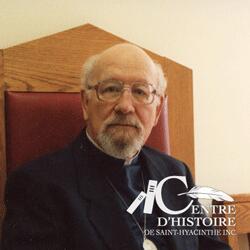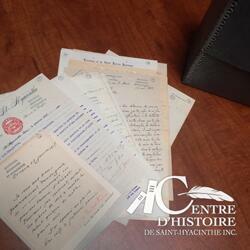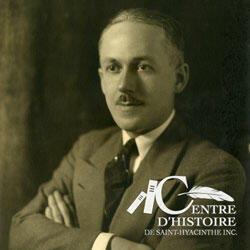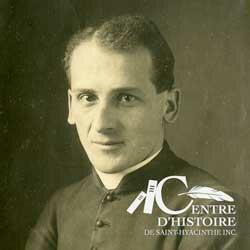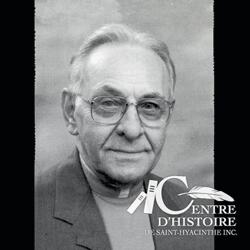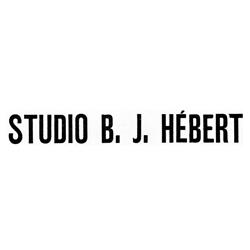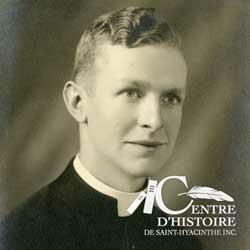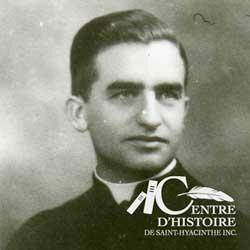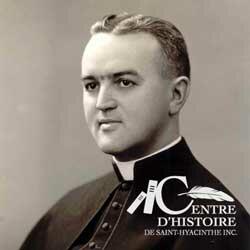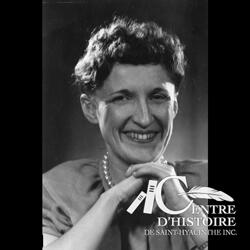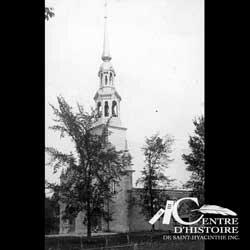Lorsque l’abbé Antoine Girouard entre en fonction à titre de curé de la paroisse de Saint-Hyacinthe en 1805, lui et la population ne se doutent pas du profond impact qu’il aura sur la naissance, la mise en place et la consolidation d’un système d’enseignement en sol maskoutain. Débutant par des cours de catéchisme au presbytère et dans certains rangs, il réalise rapidement que la présence d’une institution offrant le cours classique permettrait de suppléer au manque criant de prêtres dans la région tout en offrant une formation supérieure pour ceux ne désirant pas se consacrer à la carrière religieuse. Ainsi naît le 8 septembre 1811 le premier collège d’enseignement secondaire et collégial pour garçons à Saint-Hyacinthe sur l’actuel site de l’évêché et de la cathédrale de Saint-Hyacinthe; les filles, elles, seront desservies dès 1816 par le couvent administré par la Congrégation Notre-Dame et fondée lui aussi par messire Girouard. Solidement appuyée et soutenue par les seigneurs de la région – les familles Delorme-Dessaulles, Debartzch, Saint-Ours –, l’institution connaîtra une croissance constante qui conduira à sa reconnaissance civile en 1832 – la maison portera dorénavant le nom officiel de Séminaire de Saint-Hyacinthe d’Yamaska; - et à sa reconnaissance canonique en 1842. La création d’un diocèse maskoutain en 1852 renforce son statut institutionnel d’enseignement et en fait un outil de développement religieux et social de renom. Au cœur de la vie religieuse du XIXe siècle, des figures notoires, telles que Joseph-Sabin Raymond, Isaac Désaulniers ou Jean-Rémi Ouellette, s’inscrivent dans les grands débats idéologiques qui marquent la société : le mouvement ultramontain, l’enseignement philosophique à partir de saint Thomas d’Aquin, les droits du pouvoir spirituel sur celui temporel, le développement l’ouest canadien pour l’établissement de francophones, etc. Du même coup, la position géographique de Saint-Hyacinthe avantage le Séminaire : l’arrivée du chemin de fer dès 1848, son statut de chef lieu de comté et de cité, ainsi que son développement comme bourg intermédiaire entre la campagne et Montréal. Le déménagement sur le site actuel du Séminaire, en 1853, montre le chemin parcouru : construction d’un édifice imposant d’après les plans de l’architecte Pierre-Louis Morin, de Montréal, aide financière gouvernementale, corps professoral des plus qualifiés et clientèle scolaire en croissance constante. L’exode démographique que connaît ce diocèse vers les grands centres industriels américains incite même les parents catholiques francophones à inscrire leur progéniture à venir étudier en français au niveau secondaire et collégial. À son centenaire célébré en grandes pompes en 1911, l’historien de la maison, l’abbé Charles-Philippe Choquette, couche sur papier l’histoire de cette maison et des principaux acteurs ayant contribué à sa renommée; une nouvelle aile, celle du centenaire, se pare d’être à la fine pointe des plus récentes exigences sanitaires dans un milieu de vie rurale des plus sereins et sécuritaires. Le XXe siècle apportera son lot de changements économique, social et culturel. Les dirigeants du Séminaire travailleront à s’adapter à chacune des étapes importantes : les deux guerres mondiales, la crise économique de 1929, l’État – autant fédéral que provincial –, qui s’immiscera dans le monde de l’éducation, des mentalités plus perméables au monde international, etc. Poursuivant sa route et sa mission d’enseignement religieux, la reconstruction de la chapelle, ainsi que des ailes latérales après l’incendie d’octobre 1927 par l’architecte maskoutain G.-René Richer (un ancien), matérialise concrètement l’envergure de l’institution. Toujours en mode proactif, les supérieurs s’adaptent aux différents modèles pédagogiques : choix de matières diversifiées, méthodes d’apprentissage évolutives, laboratoires conformes aux besoins, etc. Dès les années 1950, des tests d’admission et des mises à jour des programmes sont prémonitoires de la grande réforme de l’éducation que va connaître le Québec des années 1960. Au coeur de ce renouveau scolaire, la mission du Séminaire va, encore une fois, s’adapter. Après la création du ministère de l’Éducation du Québec, le Séminaire sera reconnu comme établissement d’enseignement privé à intérêt public. Il recevra pendant quelques années les étudiants et étudiantes du niveau secondaire maskoutain avant leur déménagement à la polyvalente Hyacinthe-Delorme. Il en sera de même pour le Cégep de Saint-Hyacinthe qui y débutera son existence. Avec un personnel religieux en déclin après les années 1970, la direction du Séminaire travaille avec les parents et les professeurs pour mettre sur pied l’École du Séminaire de Saint-Hyacinthe. En 1991, cette école deviendra autonome et prendra le nom de Collège Antoine-Girouard, tout en demeurant entre les murs de la maison maskoutaine. Le Séminaire, lui, conservera sa mission d’éducation par le biais des organismes qu’il va héberger : groupes et associations d’entraide et voyant au bien-être de la population, la bibliothèque historique des prêtres dorénavant ouverte au grand public, le Centre d’histoire régional et la Société voyant à la préservation du patrimoine religieux diocésain. On créera des services personnalisés selon les besoins du milieu religieux diocésain maskoutain : maison de retraite, infirmerie pour les prêtres, pensions, etc.
Charles-Philippe Choquette est né à Beloeil, le 9 décembre 1856. Fils de Joseph Choquette, cultivateur et de Thaïs Audet, il fait ses études classiques et de théologie au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1870 à 1880 et est ordonné à Saint-Hyacinthe le 19 septembre 1880. Il est professeur de sciences au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1880 à 1885, puis en cette dernière année, il entreprend un stage d'études à Paris. De retour au Séminaire, il reprend son poste de professeur de sciences de 1885 à 1904. De 1889 à 1901, il organise et maintient un laboratoire officiel de chimie pour le gouvernement provincial. De plus, il est professeur de physique à la succursale universitaire Laval de Montréal pendant plusieurs années à partir de 1897. Il occupe le poste de Supérieur du Séminaire de 1904 à 1913 et celui de vice-supérieur de 1913 à 1934. Nommé chanoine titulaire du Chapitre de Saint-Hyacinthe en 1906 et prélat domestique en 1912, il est nommé délégué au premier concile plénier du Canada à Québec et visiteur du Collège militaire de Kingston de 1906 à 1912. Pionnier de la radiographie en 1896 avec Mgr Laflamme de l'Université Laval à Québec, il a inauguré également trois années plus tôt le premier système électrique tri-phasé au Canada à l'usine électrique de Saint-Hyacinthe. Il s'est beaucoup intéressé aux transmissions radiophoniques. Il est un astronome de grande réputation et est reçu Docteur en Droit de l'Université d'Ottawa en 1910 et Docteur-es-sciences Honoris Causa à l'Université de Montréal en juin 1943. En outre avantageusement apprécié dans le monde des spécialistes, il est délégué du gouvernement canadien au congrès scientifique international de Paris en 1900, de la succursale universitaire Laval de Montréal au congrès des universités de l'Empire britannique à Londres en 1912 et au congrès géologique international de Toronto en 1914. Aussi il est membre de la Commission de Conservation du Canada, du Bureau des examinateurs des chimistes officiels, président honoraire de la Société Royale astronomique du Canada et l'un des membres-fondateurs de la Société internationale des électriciens de Paris. Auteur de plusieurs brochures et articles scientifiques, il a rédigé « Histoire du Séminaire de Saint-Hyacinthe », publiée en deux volumes en 1911- 1912 et « Histoire de la ville de Saint-Hyacinthe », publiée en 1930. Il est décédé le 15 février 1947 et est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe.
Émile Chartier est né à Sherbrooke le 18 juin 1876. Fils d'Étienne Chartier, avocat, et d'Henriette Blondin, il grandira au presbytère de Sainte-Madeleine avec ses deux oncles Jean-Baptiste et Victor Chartier. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1886 à 1894. Durant ses quatre années d'études théologiques à Saint-Hyacinthe, il enseigne le grec et l'anglais au Séminaire. Le 28 mai 1899, il est ordonné prêtre à Sainte-Madeleine, par Mgr Maxime Decelles. Assigné au Séminaire à titre de professeur jusqu'en 1903, il se rend étudier en Europe jusqu’en 1907. À l'Université de La Propagande à Rome, il obtient un doctorat en philosophie et à l'Université Grégorienne, un doctorat en théologie. Il étudie aussi à la Sorbonne où il se voit décerner une licence ès lettres. Revenu enseigner au Séminaire de Saint-Hyacinthe, il est recruté en 1914 par Mgr Paul Bruchési pour occuper le poste de secrétaire général et de professeur à l'Université Laval de Montréal. À la naissance de l'Université de Montréal, il fonde la Faculté des Lettres de cette institution et sera nommé vice-recteur de 1920 à 1944. Durant cette période, il donne de nombreuses conférences autant en français qu’en anglais et plusieurs titres lui sont attribués : chanoine en 1918, prélat domestique en 1939, docteur en philosophie de l'Université McGill et en lettres de l'Université Queen's. Il est un des précurseurs de l’Association catholique de la jeunesse canadienne-française, membre de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, de la Société royale du Canada, de la Société du parler français au Canada, de la Société historique de Montréal, de la Société des études grecques de France et de plusieurs autres associations. Il sera même invité à donner des cours à l'Institut catholique et à la Sorbonne à Paris. Collaborateur à plusieurs revues et journaux dont Le Pionnier de Sherbrooke et La Vérité, il publie entre autres à titre d’auteur «Pages de combat» (1911), «L'Art de l'expression littéraire» (1916), «Le Canada français» (1922), «Bréviaire du patriote canadien-français» (1925), «La vie de l’esprit» (1941) et «Poésie grecque» (1947). Il sera également directeur de plusieurs périodiques dont «La Revue canadienne», et un des directeurs de «L’Encyclopédie de la jeunesse» et collaborateur pour «Pays et nations», en plus d’être réviseur linguistique pour des projets d’écriture de d’autres auteurs. Il prend officiellement sa retraite en 1944 et déménage à Sherbrooke, où il continue à offrir son expertise et collabore à la fondation de l’Université. Il décède à Sherbrooke le 27 février 1963.
Joseph-Sabin Raymond est né à Saint-Hyacinthe le 13 mars 1810. Fils du marchand Joseph Raymond et de Marie-Louise Cartier, il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1818 à 1826. Après une année d’enseignement au Collège de Chambly, il revient au Séminaire de Saint-Hyacinthe et y consacrera toute sa carrière d’enseignant et d’administrateur de l’institution. Il enseigne successivement la grammaire (1827-1828), la rhétorique (1828 à 1832, 1833 à 1835, 1836-1837), les belles-lettres (1828-1829, 1837-1838, 1839 à 1841) la philosophie (1832 à 1836), la théologie (1852 à 1862) et sera directeur des élèves (1847 à 1849) et préfet des études (1841 à 1872, 1875-1876). Ordonné à Saint-Hyacinthe le 22 septembre 1832, il correspond avec La Mennais et Montalembert et s'intéresse au journal L'Avenir de Paris, organe des écrivains libéraux catholiques. À la suite de la condamnation de La Mennais en 1834, il s’interroge sur la nouvelle façon d’enseigner la philosophie et effectue un voyage en Europe en 1842-1843, où il rencontre, entre autres, François-René de Chateaubriand et Henri Lacordaire. À son retour au Séminaire, il occupe le poste de supérieur de 1847 à 1853 et de 1859 à 1883. Il collabore à plusieurs journaux et revues, dont les Mélanges religieux et la Revue Canadienne, et écrit de nombreux discours, éloges, sermons ainsi que des dissertations et entretiens à l'usage des élèves pour expliquer la pensée ultramontaine. En 1867, il défend les intérêts du clergé maskoutain et attaque l'anticléricalisme de l'Institut canadien de Saint-Hyacinthe et son porte-parole Louis-Antoine Dessaulles. Une vive polémique s'ensuit et les deux adversaires publient dans les journaux des lettres et des articles virulents. En plus de ses occupations au Séminaire de Saint-Hyacinthe, Mgr Raymond est Grand Vicaire du diocèse de Saint-Hyacinthe de 1852 à 1887 et administrateur du diocèse en 1862 et en 1869-1870. Il est créé prélat domestique du pape le 21 juillet 1876 et occupe le poste de chanoine titulaire de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe de 1877 à 1887. Il participe activement à la fondation du monastère des soeurs Adoratrices du Précieux-Sang avec Mgr Joseph La Rocque et contribue à la venue des Dominicains à Saint-Hyacinthe en 1873. Il décède subitement au monastère du Précieux-Sang le 3 juillet 1887 et est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe.
Pierre-Édouard Leclère naît à Montréal le 10 février 1798. Fils de Pierre Leclère dit Lafrenaye, marchand aubergiste, et de Marie-Anne Bourg, il fait sa cléricature chez les notaires Chaboillez, Mondelet et Jobin et obtient son permis de pratiquer en 1825. Le 10 janvier 1820, il épouse Marie-Josephte Castonguay, fille du marchand montréalais Jean-Baptiste Castonguay et de Marie-Josephte St-Germain dite Gauthier. De 1826 à 1835, il est propriétaire de deux journaux, le «Canadian Spectator» et «L’Ami du peuple, de l’ordre et des lois» avec l’imprimeur John Jones. En 1830, Lord Aylmer le nomme surintendant de la police de Montréal. À la suite d’un article paru dans «L’Ami du peuple», Leclère est provoqué en duel par le député patriote Édouard Rodier. La rencontre a lieu au pied du mont Royal mais ne fait pas de victimes. Durant les rébellions de 1837-1838, il est nommé juge de paix pour le district judiciaire de Montréal, devient responsable de la police secrète et émet les mandats d’arrêt contre les patriotes de 1838. Plutôt modéré dans cette tâche, il est responsable des mouvements de population à la frontière américaine, créant parfois des controverses quant à sa permissivité. À Saint-Hyacinthe, il fait arrêter Thomas Bouthillier, Eusèbe Cartier, Thomas Marchessault et le père de son futur gendre, Pierre-Claude Boucher de La Bruère. Il démissionne finalement et en 1840, il déménage à Saint-Hyacinthe pour y exercer le notariat. Cinq ans plus tard, il devient actionnaire et premier président de la Société de navigation de la rivière Richelieu. En 1851, il est de ceux qui font la promotion de la navigation sur la rivière Yamaska. Mais c’est dans le domaine agricole qu’il se fait le plus remarquer, autant à titre personnel sur sa propriété terrienne, que sur le plan professionnel, procédant à des expérimentations sur des blés et allant même en Europe pour importer du blé de la mer Noire. Le 19 mai 1852, lors de l’assemblée générale annuelle de la Société d’agriculture du Bas-Canada, il est nommé président. Leclère est aussi le promoteur et un membre-fondateur de la Société d’agriculture de Saint-Hyacinthe. Pendant toutes ces années, il gère les propriétés immobilières dont sa femme a hérité de sa mère, avec les autres membres de la famille Castonguay. Ces terrains, situés à Montréal, comprennent le commerce de la Place Jacques Cartier ayant appartenu à Jean-Baptiste Castonguay, des terrains construits dans les faubourgs Saint-Joseph et Saint-Laurent, ainsi qu’un grand verger au Côteau Saint-Louis, où se trouve de nos jours l’intersection des rues de Bleury et Sainte-Catherine. Cette dernière propriété, subdivisée en 1857, sera l’objet de plusieurs poursuites judiciaires qui déchireront parfois les membres des familles Castonguay et Leclère, et qui culminera au Conseil privé en Angleterre en 1874, soit huit ans après le décès de Pierre-Édouard Leclère. En effet, il décède le 6 mai 1866 et serait inhumé dans le cimetière Côte-des-Neiges de Montréal. Son épouse lui a donné 12 enfants, dont 7 se rendront à l’âge adulte. Parmi ceux-ci, on remarque l’avocat Charles, le médecin Georges, le fondeur Pierre-Édouard fils, François-Adolphe (Francis) qui, selon plusieurs documents, est «handicapé» et ne travaillera jamais, Elmire qui épouse Charles Nelson, Victorine qui épouse l’avocat Pierre Boucher de La Bruère, et Albertine qui se lie au prospère commerçant Alphonse Raymond.
Augustin-Norbert Morin est né à Saint-Michel-de-Bellechasse, le 13 octobre 1803. Il est le fils d'Augustin Morin, cultivateur, et Marianne Cottin dit Dugal. Il fait ses études classiques au Séminaire de Québec de 1815 à 1823 et sa cléricature tout d'abord à Québec, où il participe à la rédaction du journal «Le Canadien», puis termine son droit à l'étude de Denis-Benjamin-Viger à Montréal. En 1825, il lance une brochure revendiquant l'utilisation du français dans les cours de justice du Bas-Canada. En 1826, il est, avec Ludger Duvernay et Denis-Benjamin Viger, un des fondateurs du journal «La Minerve». Il est admis à la pratique du droit le 7 juillet 1828. Le 26 octobre 1830, il est élu député de Bellechasse à la Chambre d'Assemblée. Il représente ce comté jusqu'en 1838. En 1834, il rejoint Denis-Benjamin Viger à Londres pour présenter les pétitions de la Chambre sur l'état de la province. Cette même année, il rédige les 92 résolutions. En 1836, Morin, qui jusqu'alors se classe parmi les modérés, adopte les positions du groupe de Louis-Joseph Papineau sur le Conseil exécutif. Il prend la tête des Patriotes de Québec. Il est arrêté le 28 octobre 1839, puis relâché sans jugement «tant les accusations de haute trahison sont peu fondées». Sous l'Union, il est député de Nicolet du 8 avril 1841 au 1er janvier 1842. Il est alors nommé juge des districts de Kamouraska, Rimouski et Saint-Thomas. Il occupe ce poste jusqu'au 28 novembre 1842 lorsqu'il devient député de Saguenay. Il est nommé Commissaire des terres et développe les paroisses du nord de Montréal, dont Sainte-Adèle, Val-Morin et Morin-Heights, ainsi que la condition agricole et l'amélioration des cultures. En 1844, il est réélu député de Bellechasse. En 1845, il rédige la loi sur l’éducation qui institut la paroisse et non plus la municipalité comme base du système. En 1846 et 1847, il refuse un poste au Conseil exécutif. Il est élu président de la Chambre d'Assemblée en 1848. En 1851, il est élu député de Terrebonne et devient co-premier ministre dans le cabinet Hincks-Morin. Il occupe ce poste jusqu'en janvier 1855. Il prépare alors l'abolition du régime seigneurial qui s’applique à compter de décembre 1854. La même année, il est réélu député de Bellechasse et de Chicoutimi. En janvier 1855, il démissionne pour des raisons de santé et est nommé juge de la Cour supérieure. Il participe à la refonte de la codification des lois civiles du Bas-Canada de 1858 à 1865. Il sera également professeur et doyen de la Faculté de droit de l’Université Laval de 1854 à 1865. Il a épousé à Saint-Hyacinthe le 28 février 1843, Albine Adèle Raymond, fille de Joseph Raymond et Louise Cartier, et soeur du Supérieur du Séminaire, Joseph-Sabin Raymond. Morin décède à Sainte-Adèle, le 27 juillet 1865 et est inhumé dans le caveau de l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Saint-Hyacinthe. La translation des sépultures d'Augustin-Norbert Morin et d’Adèle Raymond est effectuée le 30 janvier 1984. Ils sont maintenant inhumés au cimetière de la paroisse Sainte-Rosalie à Saint-Hyacinthe.
François Tétreau est né dans la région de Saint-Hyacinthe sur le territoire de Saint-Damase le 11 octobre 1819, baptisé le lendemain à l’église de la paroisse Saint-Hyacinthe (Notre-Dame-du-Rosaire). Fils de François Tétreau, cultivateur, et d'Adélaïde Plamondon, il devient orphelin de mère à 5 mois et de père à 7 ans. Grâce aux bons soins du curé Michel Quintal de Saint-Damase, il fait ses études classiques et théologiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1831 à 1842. Ordonné prêtre à Saint-Damase par Mgr Ignace Bourget, le 23 octobre 1842, il s’installe en permanence au Séminaire de Saint-Hyacinthe et devient professeur de rhétorique, enseignant la littérature, l'éloquence, l'histoire et la dogmatique. Nommé procureur et économe de 1856 à 1867, avec une interruption de deux ans. Par la suite, il revient à l’enseignement de la rhétorique, des belles-lettres et de la théologie jusqu’en 1882. Durant tout ce temps où il côtoie les abbés Joseph-Sabin Raymond et Isaac Désaulniers, soit de 1849 jusqu’à son décès, il rédige une chronique des faits quotidiens à survenir au Séminaire. En parallèle, il fonde L'Union catholique de Saint-Hyacinthe, une association littéraire qui regroupe les jeunes gens et leur procure des loisirs; il en sera le directeur de 1865 à 1873. C’est à ce moment qu’il côtoie Oscar Dunn, Pierre Boucher de la Bruère et Honoré Mercier. Il s’intéresse également au sort des cultivateurs et s’implique dans l’organisation de la Société de colonisation de Saint-Hyacinthe avec l’abbé Jean-Baptiste Chartier et Jérôme-Adolphe Chicoyne. Plus tard, il se penche même sur un projet de création d’une société coopérative agricole et suggère de créer des banques agricoles. Décédé le 16 mai 1897, il est inhumé dans la crypte du Séminaire.
Jérôme-Adolphe Chicoyne est né à Saint-Pie le 22 août 1844. Il est le fils de Jérôme Chicoyne, cultivateur, et de Dorothée Deslandes. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1855 à 1863. Admis au Barreau en 1868, il installe son bureau d’affaires à Saint-Hyacinthe. Membre de la Société de colonisation de Saint-Hyacinthe, il est nommé agent d'immigration provincial en 1872. À ce titre, il donne des conférences et repère les meilleures terres à coloniser. En 1875, il fonde le village de La Patrie puis quatre ans plus tard, il déménage à Sherbrooke. Une de ses principales préoccupations sera le rapatriement des Canadiens français partis aux États-Unis, qu’il souhaite installer dans les Cantons de l’Est. Au cours d'un voyage en Europe en 1880, J.A. Chicoyne rencontre un groupe de notables de Nantes et ensemble, ils fondent la Compagnie de colonisation et de crédit des Cantons de l'Est. À son retour, il fonde le village de Woburn au sud du lac Mégantic, y établit une scierie et aide les Pères Trappistes à s’installer à Bethléem. En plus de s'occuper du recrutement des colons et du développement agricole, il collabore à titre journalistique à de nombreux périodiques, même durant ses études classiques et devient collaborateur régulier en 1881 puis rédacteur en chef du journal Le Pionnier de Sherbrooke. Il dirige également le périodique La Colonisation. Du côté politique, il sera respectivement maire de La Patrie, de Mégantic et de Sherbrooke. Le 8 mars 1892, il est élu député du comté de Wolfe à l'Assemblée législative. Il conserve ce poste jusqu'en 1904. Cette même année, il revient s'établir à Saint-Hyacinthe, dans le secteur La Providence. Il épouse, le 7 janvier 1868, Rose-Caroline Perrault, fille de Joseph-Élie Perrault, marchand, et Sophronie Marcotte. Ils auront six enfants dont seulement une fille, Émélie, leur survivra, mais sera toujours célibataire et demeurera avec ses parents. Il décède à Saint-Hyacinthe le 30 septembre 1910 et il est inhumé dans le cimetière de la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire.
Pierre Boucher de La Bruère est né à Saint-Hyacinthe le 5 juillet 1837. Fils de Pierre-Claude Boucher de La Bruère, médecin, patriote, lieutenant-colonel de milice et agent général de la colonisation, et de Marie-Hyppolite Boucher de La Broquerie. Petit-fils de René Boucher de La Bruère, colonel ayant participé à la bataille de Châteauguay, et Julie Weilbrenner, il est un des nombreux descendants de la grande famille de Pierre Boucher autant par son père que par sa mère. Il fait son cours classique au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1846 à 1854 et son droit à l'Université Laval de Québec. Il est admis au barreau du Bas-Canada le 5 mars 1860, devient juge de paix pour le district de Saint-Hyacinthe en 1875 et s’associe avec Louis Tellier et A.O.T. Beauchemin pour créer le cabinet Tellier, de La Bruère et Beauchemin à compter de 1878. Rédacteur au Courrier de Saint-Hyacinthe en 1862, il en est le propriétaire-éditeur de 1875 à 1895. Il se lance en politique et devient conseiller législatif de la division de Rougemont le 30 octobre 1877. Orateur de ce Conseil de 1882 à 1889 et de 1892 à 1895, il quitte son poste à la suite de sa nomination comme Surintendant de l'Instruction publique, poste qu'il occupera de 1895 à 1916. S’impliquant activement dans la vie sociale et économique de Saint-Hyacinthe, il participe à la milice du Régiment de Saint-Hyacinthe, fonde et préside l’École des arts et dessins de 1874 à 1879, s’occupe des Anciens du Séminaire de Saint-Hyacinthe, collabore à l’organisation de la Société d’industrie laitière de la province de Québec de 1882 à 1889 et sera même nommé administrateur de l’Orphelinat de Saint-Hyacinthe. Il s’occupe aussi du dossier du développement de l’industrie de la betterave à sucre et s’implique au sein d’organismes de protection de la langue française, soit L’Athénée louisianais et la Société du parler français au Canada, dont il sera le président de 1903 à 1906. En plus de ses articles de journaux, il publie quelques ouvrages à caractère historique : «Le Canada sous la domination anglaise» en 1863 et «Histoire du Séminaire de Saint-Hyacinthe» en 1879, ainsi que des ouvrages sur l’éducation dont «Éducation et constitution» en 1904. Le 8 janvier 1861, il épouse Marie-Victorine-Alice Leclère, fille du notaire Pierre-Édouard Leclère et de Marie-Josephte Castonguay. Le couple aura neuf enfants dont le deuxième garçon, Montarville Boucher de La Bruère, sera le premier chef des nouvelles du journal Le Devoir avant de devenir archiviste pour les Archives publiques du Canada, s’impliquant notamment au sein de la Société historique de Montréal et Les Cahiers des Dix. Pierre Boucher de La Bruère décède à Québec le 6 mars 1917 et est inhumé dans le cimetière de la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire à Saint-Hyacinthe.
Isaac-Stanislas [Lesieur-]Désaulniers est né à Sainte-Anne de Yamachiche le 27 novembre 1811. Fils de François Lesieur-Désaulniers, cultivateur et député de Saint-Maurice à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada, et de Charlotte Rivard-Dufresne, il fait ses études classiques au Séminaire de Nicolet et est ordonné par Mgr Ignace Bourget le 30 juillet 1837. Ayant auparavant pris l'habit ecclésiastique en 1829, il enseigne les sciences au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1829 à 1833 et la philosophie de 1831 à 1833. Puis il quitte pour étudier les sciences et l'anglais à l'Université des jésuites de Georgetown à Washington en 1833-1834. Revenu au Séminaire de Saint-Hyacinthe, il enseigne la physique de 1834 à 1839 et de 1844 à 1847 et également la philosophie de 1837 à 1849. L’abbé Désaulniers introduit l'enseignement de la chimie agricole et de l'économie politique en 1845 puis donne des cours de théologie de 1847 à 1852. Grâce à des fonds privés, il entreprend un voyage en Europe et au Proche-Orient d'août 1852 à mars 1854 avec le jeune Louis-Rodrigue Masson. Là-bas, il visite les bibliothèques universitaires et les cabinets de physiques européens. Avant son retour, il est nommé supérieur du Séminaire de Saint-Hyacinthe et demeurera en poste jusqu’en 1859. Durant ce mandat, Mgr Bourget l'envoie à Chicago de novembre 1856 à juin 1857 pour ramener dans le droit chemin son ancien confrère d’école, le « shismatique » Charles Chiniquy. Après avoir terminé son mandat de supérieur, il redevient professeur de philosophie en introduisant la pensée de saint Thomas d'Aquin et donne plusieurs conférences sur ce sujet. Nommé grand vicaire en 1866, il participe à la polémique qui oppose Mgr Joseph-Sabin Raymond et Louis-Antoine Dessaulles en critiquant une conférence de ce dernier. Il décède au Séminaire de Saint-Hyacinthe le 22 avril 1868 et est inhumé dans la crypte de cette institution.
Godfroy Lamarche est né à Sainte-Anne-de-Bellevue, le 8 septembre 1831. Il est le fils de Joseph Petit-Lamarche et d'Élisabeth Booth. Il fait ses études classiques au Séminaire de Sainte-Thérèse de 1845 à 1852 et au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1852 à 1857. Il est ordonné prêtre à Saint-Hyacinthe, le 11 octobre 1857. Au Séminaire, il est professeur de belles-lettres de 1857 à 1860 et de rhétorique en 1860-1861. De 1861 à 1879, il est chapelain de la cathédrale de Montréal puis chanoine au même endroit de 1869 à 1879. Il exerce son ministère à Saint-Bruno-de-Chambly de 1879 à 1888. En 1867, il fonde le journal Le Nouveau Monde (1867-1900), une publication ultramontaine qui se veut porte-parole de l’évêque de Montréal. Le journal affrontera le journal La Minerve, un journal à saveur libéral. Il décède à l'Hôtel-Dieu de Montréal, le 17 juillet 1888, et est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe.
Joseph-Eugène-Ernest Laferrière est né Berthierville, le 10 avril 1874. Il est le fils de François-Xavier Laferrière, cultivateur, et de Georgina Gervais. Il fait ses études classiques et théologiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1886 à 1900. Premier prêtre ordonné par Mgr Herman Brunault, le 23 septembre 1900, il occupe le poste de professeur de méthode au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1900 à 1907. Il est étudiant à Rome de 1907 à 1909 où il reçoit un doctorat en philosophie de l'Université de la Propagande. Il étudie ensuite six mois à Paris avant de s'inscrire à l'université de Louvain en Belgique, de 1909 à 1912. Il y obtient un doctorat en sciences morales et historiques avec sa thèse sur Jean Duvergier de
Hauranne, abbé de Saint-Ours de Cyran, 1581-1643, publiée à Louvain en 1912. A la fin de ses études, il visite l'Italie, la France, la Belgique, la Suisse, l'Angleterre et la Palestine. Il enseigne l'histoire au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1912 à 1936. Aumônier chez les Frères Maristes de 1914 à 1925, il a fortement contribué à la venue des Bénédictins à Saint-Benoit-du-Lac, au Québec. L'abbé Joseph Laferrière est aussi inventeur, en 1915, d'un pneu pour automobile. Il décède à l'hôpital Saint-Charles le 19 novembre 1936 et est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe.
Pierre-Jude-Amédée Dumesnil est né à Coteau-du-Lac, le 28 octobre 1836. Il est le fils de Joseph Dumesnil, cultivateur, et de Marie-Louise Beaudry. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1847 à 1855, puis entreprend sa cléricature tout en enseignant la physique. Il est ordonné prêtre par Mgr Joseph Laroque, à Coteau-du-Lac, le 24 septembre 1859. Il est professeur de physique au Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1859-1860. De santé fragile, il consacre les années 1860 à 1862 à des voyages au Canada et en Europe. À son retour, il est directeur du collège de Saint-Jean-d'Iberville de1862 à 1863 puis professeur de mathématiques de 1863 à 1868 et de philosophie de 1868 à 1871 au Séminaire de Saint-Hyacinthe. En 1871-1872, il accompagne sept religieuses du Bon-Pasteur lors de la création d'un couvent à Lima au Pérou. Il est procureur du Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1872-1873 et professeur de philosophie de 1873 à 1892. Supérieur du Séminaire en 1892, il reste en poste jusqu'en 1901. De 1901 à 1906, il enseigne la théologie. Il est chanoine titulaire de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe de 1893 à 1911. Il décède le 7 décembre 1911 et il est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe.
Jean-Rémi Ouellette est né à Sandwich en Ontario, le 26 décembre 1830. Il est le fils d'Antoine Ouellette, journalier, et de Catherine Bézaire. Il est inscrit à l'école protestante de son village puis, encouragé par les jésuites, il est envoyé au Séminaire de Saint-Hyacinthe, en 1847. Il termine son cours en 1853 et est délégué par Mgr de Charbonnel au Séminaire Saint-Sulpice de Paris pour compléter sa théologie. Il est ordonné à Paris, le 20 décembre 1856. Vicaire à Sainte-Marie de Toronto en 1857 et de 1857 à 1859,vicaire puis curé à la Cathédrale de Toronto, il revient au Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1859 pour occuper le poste de professeur de belles-lettres, de rhétorique, de versification, de philosophie et de théologie jusqu'en 1874. Il est préfet des études de 1872 à 1875 et de 1876 à 1881 et directeur des élèves de 1873 à 1875 et en 1882-1883. Il enseigne à nouveau la philosophie de 1880 à 1882 et la théologie de 1882 à 1886. Supérieur du Séminaire de 1883 à 1892 et de 1901 à 1904, il fonde en 1883 avec Mgr Louis-Zéphirin Moreau, la communauté des Sœurs de Sainte-Marthe. Nommé chanoine titulaire de la cathédrale de 1877 à sa mort et grand-vicaire de l'évêque de Nicolet à partir de 1885, il décède le 4 octobre 1904 et il est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe.
André Dubreuil est né à Saint-Césaire, le 7 janvier 1863. Il est le fils de Louis Dubreuil, cultivateur et de Priscille Daignault. Il fait ses études classiques et théologiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1876 à 1888 et est ordonné, par Mgr Louis-Zéphirin Moreau, le 16 septembre 1888. Il est professeur de mathématiques au Séminaire de 1888 à 1890 et de 1892 à 1894. Il fait un voyage d'études à Paris de 1890 à 1892. Il occupe le poste de procureur du Séminaire de 1894 à 1940 et est chanoine titulaire de la Cathédrale de 1925 jusqu'à son décès survenu le 15 juin 1940. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe.
Joseph-Omer Blanchard est né à Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 27 octobre 1859. Il est le fils de Toussaint Blanchard, cultivateur, et de Luce Paré. Il fait ses études classiques et sa théologie aux séminaires de Saint-Hyacinthe et de Montréal de 1870 à 1883. Il est ordonné dans sa paroisse natale, le 19 août 1883, par Mgr Louis-Zéphirin Moreau. Il enseigne la grammaire française au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1883 à 1901 et l'histoire moderne de 1895 à 1902. Il décède le 21 janvier 1903 et il est inhumé dans la crypte du Séminaire.
Joseph-Philéas-Alphonse Gervais est né à Notre-Dame-de-Stanbridge, le 26 avril 1894. Il est le fils de Léandre Gervais, contremaître d'usine, et d'Olivine Benoit. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1906 à 1915 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1915 à 1919. Il est ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Alexis-Xiste Bernard, le 25 juillet 1919. Il est professeur au Séminaire de Sherbrooke en 1919-1920 puis exerce son ministère, d'abord comme vicaire, à Marieville en 1920-1921 puis à Saint-Césaire de 1921 à 1923. Il rédige et publie « l'Album-souvenir du collège commercial de Saint-Césaire » en 1923. Il est ensuite aumônier du collège commercial de Famham de 1923 à 1930, vicaire à Saint-Hugues en 1930-1931, aumônier de ]'Hospice Saint-Victor de Beloeil de 1931 à 1933, aumônier des Soeurs de Sainte-Marthe de 1933 à 1938, curé à Saint-Marcel de 1938 à 1944 et curé à Sainte-Victoire de 1944 à 1947. Il décède le 29 juin 1947 et il est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe.
Joseph-Arthur Balthazard est né à lberville, le 3 novembre 1856. Il est le fils de Joseph Balthazard menuisier, et d'Élodie Davignon. Il fait ses études classiques et théologiques au Séminaire de SaintHyacinthe de 1871 à 1881. Il est professeur d'anglais au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1881 à 1883 et de latin de 1883 à 1887. Il étudie à Rome de 1887 à 1891 et obtient un doctorat en philosophie et des licences en théologie et en droit canonique. Il est professeur de rhétorique au Séminaire de 1891 à 1895 et de philosophie de 1895 à 1910. Il exerce son ministère comme curé à L'Ange-Gardien-de-Rouville de 1910 à 1915 et à Saint-Aimé-sur-Yamaska en 1915-19 16. Il décède à Trois-Rivières, le 15 ao0t 1916 et il est inhumé dans le cimetière de la paroisse de Saint-Aimé.
Léon Pratte est né à Saint-Charles-sur-Richelieu, le 28 mars 1864. Il est le fils de Léon Pratte, cultivateur, et de Philomène Geoffrion. Il fait ses études classiques et théologiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1877 à 1888 et est ordonné par Mgr Louis-Zéphirin Moreau, dans la chapelle du Séminaire, le 16 septembre 1888. Il est professeur en méthode et versification de 1888 à 1893, directeur des élèves de 1893 à 1906, à nouveau professeur de 1906 à 1909 puis directeur des élèves de 1909 à 1920. En 1919, il est nommé chanoine titulaire de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe et, en 1920, il devient supérieur du Séminaire. Il décède à l'Hôpital Saint-Charles de Saint-Hyacinthe le 29 décembre 1930 et il est inhumé dans la crypte du Séminaire. Encore aujourd'hui il jouit d'une réputation de sainteté et un organisme « Le Centre de diffusion Léon Pratte » à longtemps perpétué sa mémoire et son œuvre. Une artère principale et l'ancien Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe portent son nom.
Jean-Baptiste-Olivier Archambault est né à Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 8 novembre 1876. Il est le fils de Joseph-Antoine Archambault, cultivateur, et de Philomène Lajeunesse. Il fait ses études classiques et théologiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1887 à 1900 et est ordonné à Saint-Antoine par Mgr Maxime Decelles, le 15 juillet 1900. Il est professeur de syntaxe, de belles-lettres puis de rhétorique au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1900 à 1908. Il étudie à l'Université de la Propagande à Rome de 1908
à 1910 où il obtient un doctorat en philosophie puis il suit des cours de littérature à l'Université de Fribourg, en Suisse, en 1910-1911. A son retour, il enseigne la philosophie de 1911 à 1924 et la théologie de 1917 à 1924. Il cumule différents postes au Séminaire et dans le diocèse entre 1914 et 1946; membre du bureau des censeurs du diocèse depuis 1914, aumônier des Soeurs de Sainte-Marthe de 1914 à 1916 et de 1931 à 1939, bibliothécaire du Séminaire de 1916 à 1931, membre du Conseil de vigilance du diocèse depuis 1918, directeur des séminaristes professeurs de 1917 à 1925, préfet des études de 1924 à 1931, chanoine titulaire de la cathédrale à partir de 1931 et Supérieur du Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1931 à 1939. Le chanoine Archambault s'intéresse au passé de son milieu et est membre fondateur de la première Société d'Histoire régionale de Saint-Hyacinthe fondée en 1937. Il en est le premier président du conseil d'administration. Il est l'auteur d'un « Album souvenir de la paroisse de Saint-Antoine-sur-Richelieu » en 1924 et d'une « Monographie de la paroisse de Sainte-Rosalie» en 1939. Il décède à Saint-Hyacinthe le 29 octobre 1946 et est inhumé dans la crypte du Séminaire.
Joseph-Arthur-Aldéric Vézina est né à Montréal, le 11 octobre 1869. Il est le fils de Magloire Vézina, marchand, et d'Émilie Charron. Il fait ses études classiques et théologiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1881 à 1893 et est ordonné par Mgr Maxime Decelles, le 3 mai 1893. Il exerce son ministère comme vicaire à Iberville de 1893 à 1895 puis comme aumônier du juvénat des Frères Maristes de 1895 à 1899. Il revient au Séminaire de Saint-Hyacinthe où il est professeur de méthode puis d'histoire de 1899 à 1920 et assistant-procureur de 1904 à 1920. Il est ensuite directeur des élèves de 1920 à 1925, professeur d'anglais, d'histoire et de belles-lettres de 1925 à 1934. Il cumule son poste de professeur avec celui de vice-supérieur de 1934 à 1940. Il est supérieur du Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1940 à 1944 et, à nouveau, vice-supérieur de 1944 à 1950. Il décède à l'Hôpital Saint-Charles le 15 juin 1950 et est inhumé dans la crypte du Séminaire.
Philippe Auger est né à Saint-Aimé, comté de Richelieu, le 5 février 1889. Il est le fils de Joseph Auger, cultivateur, et de Sophie Mathieu. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1903 à 1911 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1911 à 1915. Il est ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Alexis-Xiste Bernard, le 26 juillet 1915. Il est professeur de belles-lettres au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1915 à 1922. De 1922 à 1924, il étudie au Collège canadien de Rome et à l'Institut catholique de Paris. De retour au Séminaire, il est à nouveau professeur de belles-lettres de 1924 à 1930 puis directeur des élèves en 1930-1931, procureur du Séminaire de 1932 à 1944 et Supérieur de 1944 à 1947. Il décède à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, le 18 novembre 1947 et est inhumé dans la crypte du Séminaire.
Pierre-Saül Gendron est né à Saint-Simon-de-Bagot, le 1er décembre 1852. Il est le fils de Pierre-Samuel Gendron, maître d'école, notaire et député de Bagot, et de Louise Fournier. Il fait ses études classiques et théologiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1865 à 1876 et est ordonné, à Sainte-Rosalie, par Mgr Louis-Zéphirin Moreau, le 26 juillet 1876. De 1872 à 1880, il enseigne au Séminaire la méthode, la versification et les mathématiques. Il occupe ensuite le poste de directeur des élèves de 1880 à 1882 et de procureur de 1882 à 1901. De 1901 à 1916, il est curé de Saint-Hyacinthe de La Salle au Manitoba où il fait construire une église en 1914-1915. Il a publié à compte d'auteur en 1929, l'ouvrage intitulé La famille de Nicolas Gendron, dictionnaire généalogique (704 p.). Il se retire au Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1916 et y décède le 11 novembre 1931. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire.
Joseph-Gustave Roy est né à Saint-Pie, comté de Bagot, le 11 avril 1861. Il est le fils d'Amédée Roy, marchand, et d'Emma Rocher. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe, au Collège Sainte-Marie de Montréal et au Petit Séminaire de Sainte-Thérèse et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal, au Petit Séminaire de Marieville et au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1873 à 1885. Il est ordonné par Mgr Louis-Zéphirin Moreau, le 30 mai 1885. Il est professeur de rhétorique au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1884 à 1889, de méthode de 1893 à 1906 et de diction et d'histoire de 1910 à 1932. II est aussi directeur des élèves de 1889 à 1893 et de 1906 à 1910. Il fait un bref séjour en France en 1903. Retiré au Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1932, il décède le 11 juillet 1951 et est inhumé dans la crypte du Séminaire.
Joseph-Louis-Narcisse Raymond est né dans la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Saint-Hyacinthe, le 23 juillet 1879. Il est le fils d'Alphonse Raymond, marchand, et d'Albertine Leclère. Il fait ses études classiques au Séminaire de Sherbrooke de 1891 à 1898 et ses études théologiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1898 à 1902. Il est ordonné par Mgr Maxime Decelles, le 25 juillet 1902. Professeur de grammaire au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1898 à 1933, il est nommé bibliothécaire et archiviste du Séminaire de 1933 à 1951. Il fait un court séjour en Europe en 1913. Il décède à !'Hôpital Saint-Charles de Saint-Hyacinthe, le 5 mars 1952 et est inhumé dans la crypte du Séminaire.
François-Xavier Côté est né à Sainte-Rosalie, comté de Bagot, le 25 juillet 1900. Il est le fils de François Xavier Côté, cultivateur, et de Parmélie Laplante. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1914 à 1922 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1922 à 1926. Il est ordonné, en la basilique de Montréal, par Mgr Georges Gauthier, archevêque coadjuteur de Montréal, le 29 mai 1926. Il est professeur de mathématiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe, étudiant à la faculté des sciences de l'Université de Montréal en 1930-1931 ou il reçoit un certificat en mathématiques, physique et chimie. De retour au Séminaire ou, de 1931 à 1944, il enseigne la physique, la chimie et les sciences naturelles en plus d'être conservateur du musée. De 1945 à 1947, il est directeur adjoint de l'École de textile de Saint-Hyacinthe. II est aumônier diocésain de l'Union catholique des cultivateurs (U.C.C.) en 1948 puis aumônier général de l'U.C.C. Il est aussi membre de la Commission sacerdotale d'Études sociales en 1952. Il décède à l'Institut de cardiologie de l'Hôpital Maisonneuve de Montréal , le 27 août 1955 et est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe.
Pierre-Zéphirin Decelles est né à Saint-Damase, le 5 avril 1863. Il est le fils de Paul Decelles, cultivateur, et d'Éléonore L'Heureux. Il fait ses études classiques et théologiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1873 à 1882. Il prend la soutane et enseigne pendant deux ans puis il étudie une année en théologie au Grand Séminaire de Montréal. Il est ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Louis-Zéphirin Moreau, le 11 octobre 1885. Le même jour, il est nommé sous-secrétaire de l'évêché et cérémoniaire de la cathédrale jusqu'en 1893. Il occupe par la suite les postes suivants : secrétaire de l'évêché de 1893 à 1907 et en même temps vicaire général du diocèse de Saint-Hyacinthe en 1906 et 1907; chanoine titulaire de la Cathédrale à partir de 1894; curé de Saint-Pie de 1907 à 1924, où il a restauré l'église en 1910- 1911 et fondé en 1914, une académie commerciale des Frères du Sacré-Cœur. Il est aussi l'auteur du « Bulletin paroissial de Saint-Pie », publication annuelle. Nommé prélat domestique le 17 juillet 1914, il se retire à la retraite Saint-Bernard de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, le 13 août 1924 où il décède le 15 janvier 1930. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe.
Hilaire Chabot est né à Saint-Barnabé-Sud, le 24 octobre 1869. Il est le fils de Lévi Chabot, cultivateur, et d'Esther Thérien. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1881 à 1889 et sa théologie au Petit Séminaire de Marieville de 1890 à 1894. Il est ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Maxime Decelles, le 6 mai 1894. Il est professeur au Séminaire de Marieville de 1894 à 1900 et de 1902 à 1911 et directeur des élèves de 1900 à 1902. Il exerce son ministère comme curé de Fall-River de 1911 à 1930 puis se retire au Monastère du Précieux-Sang de Saint-Hyacinthe. li y décède le 20 mars 1954 et est inhumé au cimetière de la paroisse de Saint-Barnabé-Sud.
Magloire Laflamme est né à Saint-Denis-sur-Richelieu, le 18 décembre 1848. Il est le fils de Jean-Baptiste Laflamme, sacristain, et de Marie-Anne Vigeant. Il fait ses études classiques et théologiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe moins un an de théologie à Sorel et une autre année au Grand Séminaire de Montréal. Il est ordonné à Saint-Denis par Mgr Charles Larocque, le 27 octobre 1872. Il exerce son ministère comme vicaire à Saint-Ours en 1872-1873, à Saint-Marcel et à Saint-Robert en 1873, à Saint-Pierre de Sorel de 1873 à 1876 et quatre mois à Saint-Aimé en 1875. Il est curé-fondateur de Saint-Louis-de-Bonsecours en 1876-1877 et y construit l'église et le presbytère puis est curé d'Upton de 1877 à 1885 où il fonde le couvent des Sœurs de La Présentation. Il est ensuite assistant-curé puis curé à la paroisse de Notre-Dame de Lourdes de Fall-River, au Massachusetts, de 1885 à 1888. Il est aumônier au Monastère du Précieux-Sang de Saint-Hyacinthe de 1888 à 1894 puis curé de Saint-Hilaire de 1894 à 1900. Il procède à la restauration de l'église en 1896-1897. Il est enfin curé de Farnham de 1900 à 1915 et y fait rebâtir l'église incendiée en 1906. Il se retire à Montréal en 1916-1917 puis à Saint-Hyacinthe en 1917. Il est fait chanoine honoraire de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe en 1912. Il décède à Saint-Hyacinthe, le 19 février 1926 et est inhumé dans l'église de Farnham.
François-Hyacinthe Langelier est né à Saint-Hyacinthe, le 9 juillet 1875. Il est le fils de Magloire Langelier, contremaître, et de Philomène Gendron. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe et au Collège de Nicolet de 1887 à 1895 et sa théologie à Saint-Hyacinthe de 1895 à 1899. Il est ordonné dans la chapelle du Précieux-Sang par Mgr Maxime Decelles, le 3 avril 1899. En 1896, il a pris la soutane et enseigne une année au Collège de Nicolet. De santé fragile, il est assigné à l'évêché de Saint-Hyacinthe, comme assistant-procureur, à partir de 1899. Il remplit aussi la fonction d'archidiacre de 1911 jusqu'à sa mort. En 1910, sous le pseudonyme de Jules Morgan, il rédige une histoire de la région maskoutaine intitulée « En marge du temps, Saint-Hyacinthe sur l'Yamaska ». Il rédige aussi« Notes pour l'histoire de Saint-Hyacinthe » qui s'avère être un précieux répertoire biographique pour le chercheur contemporain. Il décède à l'Hôpital Saint-Charles de Saint-Hyacinthe, le 23 mars 1922 et est inhumé dans la crypte du Séminaire.
Henri-Pierre-Adélard Mongeau est né à Saint-Hyacinthe, le 30 mars 1888. Il est le fils d'Adélard Mongeau, tailleur de cuir, et de Malvina Guilbert. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1900 à 1911 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1911 à 1915. Il est ordonné à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe par Mgr Alexis-Xyste Bernard, le 26 juillet 1915. Il est professeur au Séminaire en éléments-latins de 1915 à 1927, en syntaxe de 1927 à 1930, d'arithmétique et d'algèbre en 1930-1931, d'histoire en 1931-1932. Il occupe les postes d'assistant-procureur et de cérémoniaire de 1931 à 1944 et de vice-supérieur du Séminaire de 1953 à 1955. Il est fait chanoine titulaire de la Cathédrale en 1952. Il prend sa semi-retraite en 1955 et accepte le poste d'aumônier des Sœurs de Sainte-Marthe au Séminaire jusqu'à son hospitalisation à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe en 1971. C'est là qu'il décède Je 15 avril 1972 et il est inhumé dans la crypte du Séminaire.
Jacques-Antoine-Honorat Gendron est né à Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 23 décembre 1886. Il est le fils d'Horace Gendron, cultivateur, et de Valida Archambault. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1901 à 1909 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1909 à 1913. Il est ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Alexis-Xyste Bernard, le 25 juillet 1913. Il est professeur de syntaxe au Séminaire de 1913 à 1918 puis vicaire de Saint-Césaire de 1918 à 1920. Il est étudiant à l'Université thomiste Angélique de Rome en 1920-1923 d'où ii revient docteur en philosophie et en théologie. En 1923, il est successivement desservant à Saint-Marc-sur-Richelieu et vicaire à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe et dans la paroisse de Saint-Jean-Baptiste de Rouville. De 1923 à 1932, il est aumônier à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe et de 1932 à 1939, il exerce son ministère, comme curé de la paroisse de Sainte-Brigide d'Iberville. Retiré à la retraite Saint-Bernard de l'Hôtel-Dieu, il y décède le 21 mai 1944. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe. Il est le neveu du chanoine Olivier Archambault.
Jean-Baptiste-Horace Archambault est né à Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 8 avril 1887. II est le fils de Joseph-Antoine Archambault, cultivateur, et de Délia Giard. II fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1900 à 1908 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1908 à 1912. Il est ordonné par Mgr Alexis-Xyste Bernard, le 25 juillet 1912. Il est maître de discipline au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1912 à 1914 puis professeur de latin de 1914 àl916. Il exerce son ministère comme vicaire à Saint-Pierre de Sorel de 1916 à 1919 et à Roxton-Falls en 1919-1920. Il est ensuite assistant directeur de l'Action sociale catholique agricole à Saint-Hyacinthe en 1920-1921 puis à nouveau vicaire à Saint-Pierre de Sorel de 1921 à 1925. Il est curé-fondateur de Brigham de 1925 à 1928, curé de Saint-Théodore d'Acton de 1928 à 1937 et curé de Sainte-Rosalie de 1937 à 1942. Il décède à l'Hôpital Saint-Charles de Saint-Hyacinthe le 3 juin 1942 et il est inhumé dans la crypte du Séminaire.
Gérard-Joseph-Arthur Phaneuf est né à Saint-Nicolas d'Ahuntsic, le 16 août 1921. Il est le fils d'Héliodore Phaneuf, pharmacien, et d'Alberta Martin. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1934 à 1942 et sa théologie au Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1942 à 1947. Il est ordonné par Mgr Arthur Douville, le 31 mai 1947. Il enseigne le français, le latin et les sciences religieuses aux élèves de syntaxe de 1947 à 1949. Il étudie à l'Université Angélique de Rome où il reçoit une licence en philosophie et à la bibliothèque vaticane de 1949 à 1951. Il suit des cours de philosophie à l'Institut Catholique de Paris en 1951-1952. Il revient au Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1952 comme professeur de philosophie et assistant bibliothécaire. Il est assistant aumônier national de la J.E.C. de 1957 à 1960 et aumônier national de 1960 à 1961. Il est directeur spirituel adjoint du Séminaire de 1961 à 1963 et est nommé vice-supérieur du Séminaire en 1966. Il décède à l'Hôtel-Dieu de Montréal, le 23 avril 1968 et il est inhumé dans le cimetière de la paroisse de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
François-Xavier-Isaïe Soly est né à Marieville, le 29 janvier 1832. Il est le fils de Pierre Soly, fondeur, et de Théotiste Benjamin. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1844 à 1856 et est ordonné, le 17 mai 1856, par Mgr Jean-Charles Prince. Il est vicaire à la Cathédrale en 1856 et de 1858 à 1860 et à Saint-Pierre de Sorel de 1856 à 1858. Il est ensuite curé de Saint-Hilaire de 1860 à 1866, de Saint-Jean-Baptiste de Rouville de 1866 à 1868 et de La Présentation de 1868 à 1879. Il fait un pèlerinage en Terre-Sainte en 1879 puis se retire au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1879 à 1883. Il est assistant-curé à Notre-Dame de Worcester au Massachusetts de 1883 à 1885, puis curé-fondateur de la paroisse de Notre-Dame de West-Gardner dans le même État de 1885 à 1887. Il se retire définitivement au Séminaire de Saint-Hyacinthe, en 1887. Il fit de l'étude et de la propagation de la langue Esperanto le but des dernières années de sa vie. Il décède accidentellement en tombant du troisième étage du Séminaire, le 29 mai 1903. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire.
Guy Morin est né en 1913 à Saint-Pie. Il fSt le fils de Georges-Dorèze Morin, notaire et député de Bagot à la Chambre des Communes, et d'Evelyne Morin. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1926 à 1934 et ses études de droit à l'Université de Montréal de 1934 à 1937. Il est avocat à Saint-Hyacinthe et à Montréal où il décède le 5 novembre 1958.
Fabien-Zoël Decelles est né à Saint-Damase, le 22 mai 1870. li est le fils de Fabien Decelles, commerçant, et de Mélina Dupont. Il fait ses études classiques et théologiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1883 à 1895. Il est ordonné à Saint-Damase par Mgr Maxime Decelles, le 4 août 1895. Il est professeur de belles-lettres au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1895 à 1898 puis il étudie en France, à l'Institut Catholique de Paris, de 1898 à 1900. À nouveau professeur de belles-lettres au Séminaire de 1900 à 1913, préfet des études de 1901 à 1920, vice-supérieur de 1904 à 1913 et supérieur de 1913 à 1920, il est chanoine titulaire de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe à partir de 1914, vicaire général du diocèse de 1920 à 1923, vicaire capitulaire en 1923-1924 et évêque de Saint-Hyacinthe de 1924 à 1942. Pendant son épiscopat, il participe à la création de huit nouvelles paroisses, à la reconstruction du Séminaire de Saint-Hyacinthe en partie incendié, à la construction du nouvel Hôpital Saint-Charles, à la construction de l'édifice des Sœurs de Sainte-Marthe et à la fondation du Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe. Il décède à l'Hôpital Saint-Charles de Saint-Hyacinthe, le 27 novembre 1942 et est inhumé dans la crypte de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe.
Roland-Joseph-Alphée Frigon est né à Sainte-Lucie d'Albanel, le 24 février 1914. Il est le fils de Théotime Frigon, cultivateur, et d'Angéline Piché. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1926 à 1934 et sa théologie au Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1934 à 1938, moins la première année à Montréal. Il est ordonné, à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe, par Mgr Fabien-Zoël Decelles, le 11 juin 1938. Il est professeur d'arithmétique et de sciences naturelles en syntaxe et en éléments-latins de 1938 à 1940. II étudie à l'Université Laval de Québec de 1940 à 1942 et obtient une licence en philosophie. De 1942 à 1944, il est professeur d'anglais en belles-lettres et en versification au Séminaire de Saint-Hyacinthe. Il est nommé assistant-aumônier général des Syndicats catholiques du diocèse en août 1944 puis aumônier des Syndicats catholiques nationaux dans le diocèse et aumônier de l'École de textile de Saint-Hyacinthe en 1947. Il est aussi aumônier-adjoint de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada depuis mars 1948 et aumônier de l'Union régionale des caisses populaires pour le diocèse en 1950. Il est fait chanoine honoraire de la Cathédrale en 1952. Cette même année, il est nommé responsable du Service social diocésain et, en 1956, il s'occupe de l'organisme de charité « Caritas». En juin 1963, il est nommé curé de la paroisse Sainte-Brigide d'Iberville et aumônier diocésain de la Société Saint-Jean-Baptiste. Il est ensuite curé de la paroisse Saint-Bernardin de Waterloo de 1964 à 1981. Il participe à Waterloo, à la création du centre hospitalier et à celle de la polyvalente. Il est curé de la paroisse de Saint-François d'Assise de Frelighsburg, de 1981 à 1986. Il prend sa retraite au Séminaire de Saint-Hyacinthe en juillet 1986. Il décède le 22 octobre 1989 et est inhumé dans la crypte du Séminaire.
André-Joseph Côté est né à Saint-Hyacinthe-le-Confesseur, le 6 octobre 1917. Il est le fils d'Hermann Côté, employé chez Casavant Frères, et de Régina Lincourt. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1930 à 1938 et sa théologie au Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1938 à 1942. Il est ordonné au Séminaire par Mgr Arthur Douville, le 30 mai 1942. Il est infirmier, professeur de mathématiques et d'histoire sainte au Séminaire de 1942 à 1945. Il est vicaire à Upton en 1944-1945, dans la paroisse Sainte-Famille de Granby de 1945 à 1952 et à Notre-Dame de Sorel de 1952 à 1956. Il est vicaire économe à Saint-Jude en 1957, assistant-aumônier à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe de 1957 à 1962, aumônier au Mont Sacré-Cœur de Granby de 1962 à 1965 et curé de Sainte-Brigide en juillet-août 1965. Il décède le 22 août 1965 et est inhumé au cimetière de la Cathédrale.
Jean-Baptiste-Arthur Guertin est né à Saint-Jean-Baptiste de Rouville, le 2 mai 1868. Il est le fils de David Guertin, cultivateur, et de Marguerite Robert-Lafontaine. Il étudie au Collège Saint-Laurent puis entre au noviciat des Oblats à Lachine, en septembre 1885. Il prononce ses vœux perpétuels en 1887 et est ordonné par Mgr Thomas Duhamel, à Ottawa, le 24 avril 1892. Il exerce son ministère comme vicaire à la paroisse Notre-Dame de Hull puis il devient missionnaire-prédicateur à la paroisse Saint-Pierre Apôtre de Montréal de 1892 à 1907 et à Saint-Sauveur de Québec de 1907 à 1910. Il est curé de Hull de 1910 à 1916 où il fonde le Bulletin paroissial, organise une caisse populaire et met sur pied une bourse en faveur des élèves pauvres. Il est aussi l'instigateur des mouvements syndicaux catholiques de Hull. De 1916 à 1932, il enseigne l'histoire du Canada et la littérature française à l'Université d'Ottawa. Il décède en 1932.
L'Ordre de Jacques Cartier est fondée à Ottawa, en octobre 1926. Cette société secrète recrute des membres dans tous les secteurs d'activités et jouit de l'appui des autorités ecclésiastiques. L'Ordre de Jacques Cartier que l'on désigne familièrement sous le nom de « Patente » possède un organe officiel « L'Émerillon ». Le caractère xénophobe de la Société est considéré comme une entrave à la démocratie et après plusieurs dénonciations, le mouvement disparaît définitivement en 1965.
Pierre-Athanase Legros-Saint-Pierre est né à Saint-Pie de Bagot, le 3 avril 1859. Il est le fils de Pierre-Hubert Legros-Saint-Pierre, cultivateur, et d'Hélène Arpin. Il fait ses études classiques et théologiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1871 à 1883. Il est ordonné au Séminaire par Mgr Louis-Zéphirin Moreau, le 24 août 1883. En 1883-1884, il est professeur de grammaire en classe de Syntaxe au Séminaire. Il exerce son ministère comme vicaire à Saint-Robert et à Saint-Simon de Bagot en 1884, à Saint-Alexandre d'Iberville en 1884-1885, à Saint-Charles-sur-Richelieu de 1885 à 1887 et à Beloeil en 1887-1888. Il est ensuite desservant à Roxton-Falls en 1888-1889, vicaire à Saint-Jude en 1889, à Saint-Robert en 1889-1890 et desservant à Saint-Angèle-de-Monnoir en 1890-1891. Il est curé à Frelighsburg de 1891 à 1897, à Saint-Alphonse-de-Granby en 1897-1898, à Sainte-Prudentienne de 1898 à 1901, de Saint-Jean-Baptiste de Rouville de 1912 à 1921 et de Saint-Aimé en 1921-1922. Il se retire à Saint-Hyacinthe de 1922 à 1927 et est maître de discipline au Séminaire. Il est aumônier des Sœurs de Sainte-Marthe de 1927 à 1931, nommé chanoine honoraire de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe en mai 1930 et aumônier de la maison d'Youville des Sœurs de la Charité. À cette date, il se retire à l'Hôtel-Dieu. Il met à profit ses loisirs pour accumuler, à l'endos de papiers de toutes sortes, des notes historiques, biographiques, généalogiques ainsi que plusieurs monographies paroissiales. Il fréquente le Palais de Justice, les greffes de notaires et scrute les registres paroissiaux. Les textes manuscrits ou imprimés qu'il produit sont cependant teintés de préjugés et d'opinions personnelles. Il décède à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, le 17 septembre 1953 et il est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe.
Charles-Émile Gadbois est né à Saint-Barnabé-Sud, près de Saint-Hyacinthe, le 1er juin 1906. Il est le fils de Prosper Gadbois, propriétaire du magasin général, agent d'immeuble et maire de 1917 à 1925, et de Célina Germain. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1918 à 1926 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1926 à 1930. Durant ses études théologiques, il est nommé maître de chapelle au Grand Séminaire. En 1930, il décroche le titre de Lauréat de la Schola Cantorum de l’Université de Montréal en chant grégorien. Ordonné prêtre dans la chapelle du Séminaire de Saint-Hyacinthe par Mgr Alfred Langlois, évêque de Valleyfield, le 14 juin 1930, il devient professeur auxiliaire de grammaire, de liturgie mais surtout de chant et de musique des l’automne 1930 jusqu’en 1944 et s'impose très tôt comme directeur de l'orchestre et de la fanfare du Séminaire. Il fonde La Bonne Chanson en octobre 1937 afin de publier et diffuser la chanson française et canadienne-française et compose lui-même certaines partitions musicales, dont la musique du Chant du 3e Centenaire de Montréal en 1942. Il fera des voyages au Canada, aux États-Unis et en Europe, notamment au Vatican où il rencontre le Saint Père à plusieurs reprises. Nommé membre fondateur de la Préservation de la foi de Jérusalem et récipiendaire de la Croix d'Or de Latran et de l'Ordre des Chevaliers du Sinaï, il reçoit également le titre de Chevalier de l'ordre académique «Honneur et mérite» de la Société du bon parler français, dont il est membre durant plusieurs années. Son mandat d’«Apôtre de la Bonne Chanson» s’étend même à la fondation d’un poste de radio (CJMS) avec son frère Raoul. Ils travailleront aussi conjointement à un projet grandiose de Centre musical canadien qui, malheureusement, ne se concrétisera pas car en 1955, après une polémique religieuse et des tracas financiers, on procède à la vente de l'entreprise; les Frères de l'Instruction chrétienne de La Prairie en deviennent les nouveaux dirigeants. De 1955 à 1958, Mgr Georges Cabana le recrute comme vicaire de la paroisse Sainte-Famille de Sherbrooke. Il sera également aumônier de l’école secondaire Sacré-Cœur de Granby puis, de 1958 à 1960, au Collège Mont Saint-Bernard de Sorel. Admis chez les Cisterciens de Rougemont en 1960, il y fait sa profession temporaire en avril 1962. Victime d'une embolie cérébrale en septembre de la même année, il se retire à Montréal avec sa sœur Rose-Alma. Il décède le 24 mai 1981, un an après avoir célébré son 50e anniversaire de sacerdoce, à peine une semaine avant son 75e anniversaire de naissance et est inhumé dans la crypte du Séminaire.
Daniel Johnson est né à Danville, comté de Richmond, le 9 avril 1915. Il est le fils de Francis Johnson, journalier, et de Marie Daniel. Il fait ses études primaires chez les Frères du Sacré-Cœur de Danville de 1922 à 1928, ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1928 à 1935 et son droit à l'Université de Montréal de 1935 à 1940. Il est admis au barreau, le 2 juillet 1940. Il est conseiller juridique de la Chambre de commerce des jeunes du Canada, puis de l'Association des hebdomadaires canadiens français. Il est aussi conseiller du Conseil central des syndicats nationaux de Montréal et journaliste au « Quartier Latin » et à « La Patrie ». Le 2 octobre 1943, Daniel Johnson épouse Reine Gagné de Montréal. Le 18 décembre 1946, il devient député de Bagot. Il sera élu à toutes les élections 1948, 1952, 1956, 1960, 1962 et 1966. En 1954, il est adjoint parlementaire du premier ministre Maurice Duplessis. En 1955, il est nommé président des comités de la Chambre et orateur suppléant. Le 30 avril 1958, il prête serment comme ministre des Ressources hydrauliques. À ce titre, il termine les aménagements de la rivière Bersimis et met en chantier les travaux du barrage de Carillon sur l'Outaouais et ceux de la Manicouagan et de la Rivière-aux-Outardes. Il écrit, en 1965, un livre qui aura du poids dans le destin politique du Québec : « Égalité ou Indépendance». Il est élu chef de l'Union Nationale en septembre 1961 et est chef de l'opposition jusqu'au 5 juin 1966. Il est alors élu Premier ministre de la Province de Québec, poste qu'il occupe jusqu'à son décès, survenu à Manic 5, le 26 septembre 1968. Il est inhumé dans le cimetière de la paroisse de Saint-Pie de Bagot.
Félix Desrochers est né à Saint-Charles-sur-Richelieu, le 13 avril 1886. Il est le fils de Charles Desrochers, carrossier, et de Hermine Geoffrion. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1897 à 1905 et son droit à l'Université Laval de Montréal de 1905 à 1908. Il est reçu avocat en juillet 1908 et exerce à Montréal, puis à Saint-Hyacinthe où il se présente comme candidat conservateur aux élections provinciales de 1916. Il est facilement défait par T.-D. Bouchard. En 1930, il est nommé conservateur de la Bibliothèque municipale de Montréal et, le 11 février 1933, il devient conservateur de la Bibliothèque du Parlement à Ottawa. Il succède ainsi à un autre maskoutain Me Jean de La Broquerie Taché. Il est conférencier pour les Semaines sociales en 1941, 1944, 1946, 1947 et 1951, et délégué canadien à la troisième Conférence de l'Unesco, tenue à Beyrouth, au Liban, du 17 novembre au 11 décembre 1948. Il est un orateur et un musicien remarquable. Il prend sa retraite en 1956 et s'installe à Saint-Hyacinthe, où il occupe le poste de bibliothécaire du Séminaire de 1957 à 1967. Il décède le 6 avril 1969 et est inhumé au cimetière de la paroisse de Saint-Charles-sur-Richelieu. Il a épousé en premières noces, le 17 juin 1913, Rita Duckett et en secondes noces, le 12 août 1942, Corinne Corriveau.
Jean-Baptiste-Arthur Allaire est né à Saint-Barnabé Sud, le 22 juillet 1866. Il est le fils de Jean-Baptiste Allaire, menuisier, et d'Adéline Courtemanche. Il fait ses études classiques et théologiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1878 à 1890. Il est reçu bachelier ès lettres de l'Université Laval en 1886 et est ordonné, dans la chapelle du Séminaire, par Mgr Louis-Zéphirin Moreau, le 28 septembre 1890. Il exerce son ministère comme vicaire à Saint-Hilaire en 1890-1891, à Sainte-Rosalie en 1891-1892, à Saint-Pie en 1892, à Saint-Dominique en 1892-1893, de nouveau à Saint-Hilaire en 1893-1894, à Saint-Denis de 1894-1897 et à Sainte-Angèle-de-Monnoir en 1897. Atteint par la maladie, il est au repos à Saint-Roch-sur-Richelieu d'octobre à décembre 1897. Il est ensuite vicaire dans la paroisse du Saint-Nom-de-Jésus, à Worcester, dans le Massachusetts, puis à Saint-Roch de 1899 à 1900. Il est ensuite aumônier de l'Hospice Saint-Victor de Beloeil en 1900-1901, missionnaire agricole diocésain en 1901-1902 et auxiliaire à Upton d'octobre à décembre 1902. Il est curé d'Adamsville de 1902 à 1906, de Saint-Thomas-d'Aquin de 1906 à 1913 et à Sainte-Cécile de Milton de 1913 à 1916. Il effectue un voyage d'études sociales agricoles en France, en Belgique et en Angleterre en 1914. À son retour, il est nommé par le gouvernement du Québec missionnaire d'action sociale agricole pour toute la province. Il remplit cette tâche de 1915 à 1921. Il est ensuite curé de Mont-Saint-Grégoire de 1921 à 1924, à Saint-Liboire de 1924 à 1927, vicaire forain de 1926 à 1928 puis archidiacre à l'évêché de Saint-Hyacinthe et aumônier diocésain de l'U.C.C. en 1927-1928. Nommé chanoine honoraire de la Cathédrale en 1928, il se retire au Séminaire la même année. Auteur de nombreux ouvrages dont L'Histoire de la paroisse de Saint-Denis-sur-Richelieu en 1905, du Dictionnaire biographique du clergé canadien-français en six volumes, parus de 1908 à 1934 , de Nos premiers pas en coopération agricole en 1916, des Règlements de la Confédération des sociétés coopératives agricoles du Québec en 1919 et de deux Album du clergé séculier du diocèse de Saint-Hyacinthe en 1919 et en 1935. Il est aussi fondateur et rédacteur du journal hebdomadaire Le coopérateur agricole publié à Saint-Hyacinthe de 1916 à 1921. Il est un des fondateurs de la première Société d'Histoire régionale de Saint-Hyacinthe en 1937. Il décède le 9 octobre 1943 et est inhumé dans la crypte du Séminaire.
Aurélie Caouette est née à Saint-Hyacinthe, le 11 juillet 1833. Elle est la fille de Joseph Caouette, forgeron, et de Marguerite Olivier. Elle fréquente l'école du village puis, en 1845, elle entre au pensionnat des religieuses de la Congrégation de Notre-Dame à Saint-Hyacinthe. Elle a comme directeur spirituel Joseph-Sabin Raymond, Supérieur du Séminaire de Saint-Hyacinthe. Elle quitte le pensionnat en 1850 et entreprend de trouver sa voie dans le mysticisme. Elle est, durant la période qui va jusqu'en 1860, l'objet de phénomènes inexplicables: maladies étranges, changements subits de couleur des vêtements qu'elle porte, objets qui deviennent brulants entre ses mains. Avec l'appui de Mgr Ignace Bourget et de l'abbé Raymond, elle fonde, le 14 septembre 1861, la communauté des Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang. De 1861 à 1863, la première communauté contemplative au Canada loge dans la maison paternelle. Le 14 septembre 1863, quatre religieuses prononcent leurs vœux et prennent possession du nouveau monastère. En 1866, il y a 18 professes et 9 novices. En 1893, le Saint-Siège approuve les règles de la constitution de la congrégation. La communauté prend rapidement de l'expansion et des monastères sont établis à Toronto en 1869, à Montréal en 1874; à Ottawa en 1887; à Trois-Rivières en 1889; à Brooklin, New York, en 1890; à Portland, Orégon, en 1892; à Sherbrooke et à Nicolet en 1895 et 1896; à Manchester, New Hampshire, en 1898 et à La Havane, Cuba, en 1902. Aurélie Caouette, qui a pris le nom de mère Catherine-Aurélie du Précieux-Sang, préside à l'inauguration de chacun des nouveaux monastères. En plus d'être Supérieure de la communauté de Saint-Hyacinthe, elle est, par faveur papale, Supérieure générale à vie. Aurélie Caouette décède au monastère de Saint-Hyacinthe, le 6 juillet 1905. Elle est inhumée dans le cimetière de la communauté. Un procès de béatification est présentement en cours à Rome.
Jules-Paul Tardive! est né à Covington dans l'état du Kentucky, le 2 septembre 1851. Il est le fils de Claude Tardivel, menuisier, et d'Isabella Brent. Au décès de sa mère, il est confié à son oncle l'abbé Julius Brent, curé de Mount Vernon, en Ohio. Il fait une partie du cours classique au Séminaire de Saint-Hyacinthe, de 1868 à 1872, puis retourne une année aux États-Unis. En 1873, il travaille pour « Le Courrier de Saint-Hyacinthe » et « La Minerve ». Le 5 février 1874, il épouse Henriette Brunelle à Saint-Hyacinthe. En juillet de la même année, il entre au journal « Le Canadien » de Québec. Dès cette époque, Jules-Paul Tardivel fait siennes les idées ultramontaines. Au « Canadien », Tardivel s'intéresse aux grandes questions politiques et s'exerce à la critique littéraire. Il fréquente le Cercle catholique de Québec, un noyau d'ultramontanisme et fait paraître plusieurs articles religieux. En 1881, Tardivel fonde son propre journal « La Vérité». Il y défend le nationalisme canadien-français et le catholicisme intégral. En tant que rédacteur en chef de « La Vérité», il mène plusieurs combats contre ceux qu'il juge trop radicaux ou trop tiède. Il rédige des textes contre Honoré Beaugrand, Wilfrid Laurier, Honoré Mercier et froisse au passage Henri Bourassa et même Mgr Louis-François Laflèche. L'affaire Riel, en 1885, divise alors fortement les ultramontains et plusieurs se rangent du côté du cabinet Macdonald. Tardivel défend Riel et adhère aux idées nationalistes de Mercier. Il critique l'Université Laval pour son libéralisme et lutte farouchement contre l'émigration des Canadiens Français aux États-Unis. En 1895, il publie Je premier roman nationaliste au Québec « Pour la Patrie » où il se montre indépendantiste. Il défend avec éloquence la langue française et critique l'emploi d'anglicismes. Tardivel est aussi fasciné par l 'occultisme et les sociétés secrètes et est un des plus ardents adversaires de la franc-maçonnerie. Jules-Paul Tardivel est en plus un grand sportif qui demeure près de la nature. Il décède à Québec, le 24 avril 1905 et il est inhumé dans Je cimetière Saint-Charles.
La communauté des prêtres de Saint-Sulpice est fondée à Paris, en 1642, par Jean-Jacques Olier de Verneuil. Arrivée au Canada en 1657, la communauté se porte acquéreure de la seigneurie de l'île de Montréal le 9 mars 1663. La communauté s'occupe du Petit et du Grand Séminaire de Montréal ainsi que de la paroisse Notre-Dame de Montréal.
Camille Cournoyer est né à Sainte-Anne de Sorel, le premier mars 1898. Il est le fils de Pierre Cournoyer, cultivateur, et de Christine Cournoyer. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1910 à 1918 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1918 à 1922. Il est ordonné, à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe, par Mgr Hermann Brunault évêque de Nicolet, le 25 juillet 1922. Il est maître de discipline et surveillant d'étude durant les années scolaires 1922-1923. Il est vicaire à Saint-Dominique de 1923 à 1932, à Saint-Pie en 1932-1933, à Saint-Césaire en 1933 et à Saint-Romuald de Farnham de 1933 à 1937. Il est curé d'Adamsville de 1937 à 1945 et de Bedford de 1945 à 1967. Il se retire à Venise-en-Québec puis à Bedford, en 1967. Il décède le 30 septembre 1977 et il est inhumé dans le cimetière de Sainte-Anne-de-Sorel.
Joseph-Hector Lemieux est né à Saint-Hugues de Bagot, le 27 septembre 1910. Il est le fils de Joseph Lemieux, cultivateur, et d'Amélia Lessard. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1924 à 1932 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1932 à 1936. Il décroche un baccalauréat en théologie en décembre 1935 et est ordonné à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe, le 6 juin 1936, par Mgr Fabien-Zoël Decelles. Il est professeur de syntaxe au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1936 à 1942 puis vicaire à Saint-Pierre de Sorel de 1942 à 1944. Il est ensuite vicaire à la paroisse Christ-Roi de Saint-Hyacinthe de 1944 à 1954. Il s'occupe alors de l'organisation des loisirs de sa paroisse et forme la première OTJ de la ville. Il fonde en 1947 les Compagnons de l'Art dans le but d'intéresser les jeunes à la musique classique. Il est aussi membre fondateur avec Gilles Lefebvre, Laurette Boisvert et Anaïs Allard-Rousseau des Jeunesses Musicales du Canada. L'organisme commence à donner des concerts en janvier 1950. Dès l'été 1951 il procède à l'ouverture du Camp musical d'Orford, aujourd'hui Centre d'Art d'Orford. De 1954 à 1963, il est curé de Sainte-Angèle de Monnoir puis de Saint-Dominique de 1963 à 1965. Il fonde alors les Loisirs Saint-Dominique. Il exerce ensuite son ministère à Saint-Césaire de 1965 à 1974 et y implante une organisation de Jeunesses Musicales du Canada. De 1974 à 1984, il est aumônier des Sœurs de La Présentation de Marie à Saint-Hyacinthe. Il se retire au Séminaire et y devient archiviste et bibliothécaire de 1989 à 1993. Il est secrétaire de la Société d'Histoire régionale de Saint-Hyacinthe et représentant du Séminaire au sein de son conseil d'administration. Il décède au Séminaire le 16 mars 1994 et il est inhumé dans le cimetière de la paroisse de Saint-Hugues.
Joseph-Alcide Roy est né à Saint-Jude, le 24 janvier 1901. Il est le fils de Joseph Roy, menuisier, et d'Hermine Larivière. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1914 à 1922 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1922 à 1926. C'est là qu'il est ordonné par Mgr Georges Gauthier, le 29 mai 1926. Au Séminaire de Saint-Hyacinthe, il est maître de discipline de 1926 à 1931, assistant-directeur en 1931-1932, professeur de syntaxe de 1932 à 1935, directeur de 1935 à 1944 et procureur de 1944 à 1972. Il est aussi vicaire dominical à Sainte-Madeleine de 1945 à 1972 et chanoine de la Cathédrale à partir de 1952. Il décède le 10 mai 1972 et il est inhumé dans la crypte du Séminaire.
Gaston Martel est né à Saint-Pie, le 22 décembre 1893, de Zéphirin Martel, cultivateur, et de Victoria Laflamme. Après des études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1905 à 1913, il entreprend sa théologie au Grand Séminaire de Montréal. Il est ordonné à la cathédrale de Saint-Hyacinthe, par Mgr A.-X. Bernard, le 25 juillet 1917. Par la suite, il enseigne au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1917 à 1922, puis est nommé vicaire à Notre-Dame de Granby de 1922 à 1924, desservant à Roxton Pond en 1924-1925, vicaire à Saint-Hugues de 1925 à 1927, à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe de 1927 à 1931, à Notre-Dame de Sorel en 1931-1932, aumônier de l'hôpital Saint-Charles, à Saint-Hyacinthe en 1932- 1933, curé de Knowlton du 3 mai 1933 à septembre 1940, de Saint-Joseph de Sorel de septembre 1940 à sa mort, survenue le 26 mai 1958, à l'âge de 64 ans. Il est inhumé à Sorel.
Pierre-Emilien Chagnon est né à Saint-Pie, le 11 novembre 1899, de Zoël Chagnon, cultivateur et d'Angélina Morin. Après des études au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1915 à 1923, il entreprend sa théologie au Grand Séminaire de Montréal pour être ordonné par Mgr Fabien-Zoël Decelles, le 11 juin 1927. Professeur au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1927 à 1929, il est nommé vicaire de Saint-Simon de Bagot en 1929-1930. Il occupe par la suite les postes suivants : vicaire à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe de 1930 à 1937, vicaire à Notre-Dame de Granby de 1937 à 1942, curé de Saint-Louis de Bonsecours de 1942 à 1954, curé de Roxton Falls de 1954 à 1966. Retiré au Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1966, il décède à !'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, le 14 octobre 1977. Il est inhumé dans le cimetière de Saint-Pie. Mgr Chagnon a été nommé camérier secret de Sa Sainteté Jean XXIII, le 26
janvier 1959.
Armand Brouillard, fils de Joseph Brouillard, cultivateur, et de Maria Desrosiers, est né à Saint-Hyacinthe, le 23 juin 1900. Après des études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1913 à 1921, des études théologiques au Grand Séminaire de Montréal de 1921 à 1924 et après une dernière année d'études cléricales au Séminaire de Saint-Hyacinthe, il est ordonné en la cathédrale de Saint-Hyacinthe, par Mgr Herman Brunault, évêque de Nicolet, le 25 juillet 1925. Au Séminaire, il occupe le poste de maître de discipline en 1925-1926, de professeur de 1926 à 1928 avant de retourner aux études, à l'Université Laval, à Québec, de 1928 à 1930 où il obtient sa licence en lettres. De nouveau professeur au Séminaire de 1930 à 1940, il effectue un voyage en Europe de juin à septembre 1938 pour être nommé aumônier diocésain de la JEC de 1940 à 1946, de la JECF de 1946 à 1949, aumônier du Comité diocésain et du Secrétariat d'Action catholique et responsable de la formation des comités paroissiaux de 1949 à 1954. Décoré de la médaille « Pro Ecclesia et Pontifice » en 1949, il occupe le poste de vice supérieur de 1950 à 1953 et de Supérieur du Séminaire de 1953 à 1959. Il est aussi directeur diocésain de l'Œuvre des vocations et vicaire forain de 1953 à 1959, directeur spirituel des élèves de 1959 à 1965, aumônier adjoint de l'hôpital Saint-Charles de Saint-Hyacinthe en 1965 et chapelain des Sœurs de Sainte-Marthe de 1965 à 1974. Il est également chanoine titulaire de 1952 à 1981 et chanoine titulaire de la Cathédrale à partir de 1981. Il a été fait prélat d'honneur du pape Pie XII en 1954. Retiré au Séminaire en 1974, devenu malade et presque aveugle, il décède au Centre hospitalier Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, le 19 novembre 1984, âgé de 84 ans. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire.
Fils de Wilbrod-Edouard Phaneuf, contremaître en construction, et de Laurette L'Heureux, Louis-Philippe Phaneuf est né à Montréal, le 4 mai 1895. Après des études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1909 à 1916, il entreprend sa théologie au Grand Séminaire de Montréal pour être ordonné par Mgr Alexis-Xyste Bernard, le 26 juillet 1920. Régent de salle au Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1920-1921, en repos de mars 1921 à février 1922, il est nommé assistant secrétaire à l'évêché de Saint-Hyacinthe de février à septembre 1922, assistant aumônier de L'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe de septembre 1922 à mai 1929. De nouveau en repos de mai à août 1929, il devient l'aumônier des Maristes à Iberville d'août 1929 à novembre 1945, puis curé de Saint-Mathias de 1945 à 1969. Retiré chez les religieuses de la Présentation de Marie, à partir du 16 juillet 1969, puis à Mont-Saint-Hilaire et finalement au Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1978 où il décède, le 28 juillet 1980, âgé de 85 ans. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire. Il a été nommé camérier secret par le pape Pie XII le 10 décembre 1954.
Gérard Barbeau est né à Manchester, New Hampshire, le 28 février 1914, d'Arthur Barbeau, marchand, et d'Alexandrine Boutin. Après des études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1934 à 1941, il entreprend des études théologiques au Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1941 à 1946. Ordonné prêtre le 15 juin 1946 en la Cathédrale de Saint-Hyacinthe par Mgr Conrad Chaumont, il est par la suite nommé vicaire à la paroisse de Saint-Antoine-sur-Richelieu en 1946-1947 et à la paroisse de Saint-Hilaire en 1947-1948. Après quelque temps de repos, il est vicaire à la paroisse Saint-Ephrem d'Upton de 1948 à 1951 puis secrétaire et assistant chancelier à l'évêché de 1951 à 1954, aumônier diocésain de la Jeunesse Indépendante Catholique Féminine - JICF et aumônier régional des Clercs Servants en 1952. En repos à lberville en 1954-1955, au Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1955 et au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1955 à 1957, il fait du ministère dans le diocèse d'Amos en 1957-1958, pour occuper la charge d'assistant procureur à l'évêché de 1958 à 1965. A l'étranger, pour le diocèse d'Oakland, aux États-Unis, il fait du ministère en 1965-1966 pour revenir en repos au Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1966. Rétabli, il est nommé vicaire à la paroisse de Mont-Saint-Grégoire en 1966-1967, aumônier de l'Hospice Sainte-Élisabeth de Farnham de 1967 à 1971, curé de la paroisse Saint-Édouard de Knowlton de 1971 à 1973. Il se retire à Saint-Hyacinthe où il décède au Centre hospitalier Honoré-Mercier, le 11 août 1980, âgé de 66 ans. Il est inhumé dans le cimetière de Saint-Athanase d'Iberville.
Rodolphe Mercure, fils de Louis Mercure, cultivateur, et de Marie D'Aragon, est né le 5 décembre 1887, à l'Ange-Gardien de Rouville. Après des études au Séminaire de Monnoir, situé à Marieville en 1903, il poursuit son cours au Collège de Nominingue tout en cumulant tour à tour les charges de préfet des études et de procureur. Ordonné prêtre le 28 mars 1914 dans l'église de Nominingue, il est le premier prêtre ordonné par Mgr François-Xavier Brunet, premier évêque du diocèse de Mont-Laurier. Il est nommé supérieur du séminaire diocésain, à Mont-Laurier, en août 1915. En 1923-1924, il entreprend de parfaire ses études universitaires à Rome. De retour, il est nommé principal de l'École normale de Mont-Laurier. En 1932, il devient curé de Saint-Jovite, poste qu'il occupe jusqu'à 1967, année au cours de laquelle il prend sa retraite pour s'établir à l'évêché de Mont-Laurier où il rend d'innombrables services à la cathédrale paroissiale et au service des communautés religieuses. Nommé consulteur diocésain en 1920 par Mgr Brunet, Mgr Mercure devient chanoine titulaire de la cathédrale lors de la fondation de celui-ci par Mgr Joseph-Eugène Limoges. En 1954, à la demande du même évêque, le pape Pie XII en fait un prélat de sa maison. Mgr André Ouellette demande pour lui à Paul VI qu'il soit nommé protonotaire apostolique en 1964. Mgr Mercure décède subitement à Saint-Hyacinthe, alors qu'il rend visite à l'une de ses nièces, le 3 août 1972, à l'âge de 84 ans. Il est inhumé à Saint-Jovite.
Joseph-Arthur-Narcisse Roy est né à Saint-Jude, le 13 février 1877, fils de Narcisse Roy et de Cordélia Leclerc. M. Roy occupe divers métiers : barbier, marchand, horloger et se passionne pour la photographie. Après la vente de son magasin situé au village, il achète une ferme dans le Haut-Salvail qu'il cultive quelques années tout en se spécialisant en aviculture. Il vend alors sa ferme et se porte acquéreur de la résidence et de l'emplacement de Toussaint Larivière. Il achète également l'ancienne résidence attenante à la beurrerie, la déménage et fonde le Couvoir Royal, dont les activités concernent la fabrication d'incubateurs et d'équipement pour l'élevage des poussins. Après quelque temps, en collaboration avec son fils, l'entreprise se spécialise uniquement dans l'incubation et la vente des poussins d'un jour. Le Couvoir Royal devient en peu de temps, le plus gros couvoir indépendant de la province avec une production annuelle de deux cent cinquante mille poussins. La forte demande pour le poulet de grill destiné aux restaurants BBQ explique ce phénomène. L'entreprise cesse ses activités en 1950 après une vingtaine d'années d'opération. Joseph-Narcisse Roy a épousé Delcina Leclerc, à Saint-Jude, le 5 juin 1911. Il est décédé et inhumé à Saint-Jude.
Léo Lanoue est né à Saint-Sébastien, comté d'Iberville, le 4 mars 1893, de Moïse Lanoue, cultivateur, et de Clémentine Kéroack. Après des études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1909 à 1916 et des études théologiques au Grand Séminaire de Montréal de 1916 à 1919, moins la dernière année au Séminaire de Saint-Hyacinthe, il est ordonné prêtre, par Mgr A.-X. Bernard, le 26 juillet 1920. À Saint-Hyacinthe, il est nommé professeur au Séminaire de 1920 à 1926, puis vicaire à la Cathédrale de juillet à octobre 1926, à Saint-Joseph de Sorel de janvier 1927 à septembre 1930, encore à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe de septembre 1930 à novembre 1934; curé de Pike River de novembre 1934 à juillet 1942 et de Sainte-Rosalie de juillet 1942 à 1964. Retiré au Séminaire de Saint-Hyacinthe à partir du 15 juillet 1964, il décède le 9 février 1979, au Centre hospitalier Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, âgé de 85 ans. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire.
Arthur Douville, est né à Saint-Casimir, comté de Portneuf, le 22 juillet 1894, fils de Trefflé-David Douville, cultivateur, et d'Eugénie Douville. Après des études classiques au Petit Séminaire de Québec et sa théologie au Grand Séminaire de Québec, il obtient, en 1919, son titre de docteur en théologie. Il est ordonné prêtre dans la basilique de Québec par le cardinal Louis-Nazaire Bégin, archevêque de Québec, le 25 mai 1919. Étudiant à Rome, à l'Angélique de 1919 à 1972, où il obtient son titre de docteur en philosophie (1922); il est par la suite assistant-directeur à l'École apostolique Notre-Dame, à Québec, de 1922 à 1924; puis directeur pour la même institution de 1924 à 1926; de nouveau aux études à Rome, à l'Angélique de 1926 à 1928, où il reçoit un diplôme de docteur en Droit canonique (1928). Il est auditeur, à Rome, du cardinal Lépicier de 1928 à 1930; Supérieur à l'École apostolique Notre-Dame de 1930 à 1939; élu évêque titulaire de Vita et auxiliaire de Mgr Fabien-Zoël Decelles, évêque de Saint-Hyacinthe, le 30 novembre 1939; sacré dans la cathédrale de Saint-Hyacinthe, le 29 janvier 1940; coadjuteur avec future succession, le 21 mars 1942. Il devient le huitième évêque de Saint-Hyacinthe le 27 novembre 1942. De plus, il est membre du conseil des Gouverneurs de l'Université de Montréal de juin 1950 à mai 1952, membre de la Commission épiscopale d'Action sociale (C.C.C.), d'octobre 1948 à décembre 1950, président de la même commission en 1952; également membre du conseil d'administration de la Société des Missions Étrangères de la province de Québec en octobre 1953. En 1952, il participe à la célébration du centenaire de la fondation du diocèse de Saint-Hyacinthe puis se rend au Concile à Rome en 1963. Démissionnaire de son poste, le 13 juin 1967, alors qu'il est âgé de 73 ans, il se retire à l'évêché de Saint-Hyacinthe. Il décède le 5 août 1986 et il est inhumé en la crypte de l'évêché. L'action catholique, l'action sociale, l'apostolat liturgique, la vie spirituelle, l'éducation chrétienne, l'œuvre des vocations et les œuvres caritatives sont parmi ses principales préoccupations, tout comme les luttes ouvrières que le Québec a connu durant les années 1940 et 1950. Son implication se retrouve dans l'École des chefs pour les cultivateurs et les ouvriers, dans la création d'un syndicat pour les employés des institutions religieuses et des fabriques paroissiales.
Jean-Paul Saint-Laurent est né à Saint-Simon de Bagot, le 5 octobre 1916. Fils de Rosaire Saint-Laurent, boucher, et de Marie-Louise Desrosiers, il fait ses études primaires au couvent des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Simon et complète en sept ans son cours classique au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1930 à 1937. Par la suite, il entre chez les Pères Assomptionnistes en 1937-1938 afin de poursuivre des études théologiques dans diverses maisons de la communauté religieuse. Il est ordonné prêtre le 28 octobre 1942, à Nîmes, par Mgr Girbeau. De retour au Canada en 1943, il complète ses études à l'Université Laval avant de devenir, durant cinq ans, professeur de français, de théâtre au collège de l'Assomption de Worcester tout en étant vicaire dominical à Millbury, Mass. Nommé en 1948 au sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir, il en fait l'œuvre de sa vie, organisant de multiples pèlerinages vers ce lieu de prière. En 1969, il a durant quelques mois la responsabilité du « Bon Dieu en automobile ». Après vingt ans au sanctuaire, il se dirige vers le Foyer Saint-Joseph, de Sherbrooke où, durant dix ans il occupe les fonctions d'animateur de loisirs et d'adjoint à l'aumônier. Il travaille en collaboration avec Télé 7 et CHLT-Radio de Sherbrooke et organise différentes activités pour l'Age d'Or. Il publie d'ailleurs une revue « Soleil du soir », qui lui permet de donner la parole aux aînés et de traiter de leurs problèmes. En 1980, il se retire au Séminaire de Saint-Hyacinthe et continue ses activités au Centre hospitalier Honoré-Mercier. Durant toutes ses années, il a signé une chronique dans les pages du Courrier de Saint-Hyacinthe, chronique présentant des réflexions sur la vie et ses aléas. Le père Saint-Laurent est l'aîné d'une famille de huit enfants et est décédé le 3 novembre 1994, à la suite de blessures survenues lors d'un accident d'automobile. Il a rédigé en 1983 : « 200 prêtres, religieux, religieuses, missionnaires sortis de la paroisse de Saint-Simon, 1832-1982 ». De plus, il a écrit plusieurs articles sur l'Age d'Or, Saint-Simon et la chanson folklorique.
Joseph-Aldée Desmarais est né à Saint-Ephrem d'Upton, le 31 octobre 1891, fils de François-Xavier Desmarais, cultivateur, et de Rosanna Tellier dit Lafortune. Après des études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1902 à 1910, il entreprend des études théologiques au Grand Séminaire de Montréal. Il est ordonné prêtre en la cathédrale de Saint-Hyacinthe, par Mgr Herman Bruneau, évêque de Nicolet, le 25 juillet 1914. Au Séminaire de Saint-Hyacinthe, il prend la charge de maître de discipline de 1914 à 1916 puis de professeur de Lettres de 1916 à 1920. Etudiant à l'Angélique à Rome de 1920 à 1922, il obtient les titres de docteur en Théologie, puis à l'Institut catholique de Paris de 1922 à 1924, il reçoit le titre de licencié ès Lettres et le diplôme d'enseignement supérieur et de pédagogie. De retour au Séminaire de Saint-Hya9inthe, il est nommé professeur de Rhétorique de 1924 à 1927 puis directeur des élèves de 1927 à 1930. Élu évêque titulaire de Ruspe et auxiliaire de Mgr Fabien-Zoël Decelles, le 30 janvier 1931, il est sacré en la cathédrale de Saint-Hyacinthe par Mgr Andrea Cassulo, délégué apostolique, le 22 avril suivant. Vicaire général et directeur de l'Action catholique diocésaine de 1931 à 1939, il est nommé premier évêque d'Amos, le 20 juin 1939 et intronisé le 20 septembre suivant par Mgr Ildebrando Antoniutti, délégué apostolique. En 1968, alors qu'il prend sa retraite, le diocèse d'Amos compte 77 paroisses et 3 missions, 170 prêtres séculiers et religieux, six communautés d'hommes et 19 de femmes. Mgr Desmarais a aussi doté son diocèse de nombreuses institutions : séminaire, écoles normales, patronage, école d'agriculture, école d'arts et métiers, école-ferme pour les Autochtones. Son dévouement à la cause de l'éducation lui vaut en 1956, lors des fêtes marquant son vingt-cinquième anniversaire de consécration épiscopale, la remise d'un doctorat Honoris Causa en pédagogie de l'Université Laval. A la même occasion, le Conseil supérieur de l'éducation lui décerne le titre de Commandeur du Mérite scolaire. Retiré d'abord à Montréal, il revient au Séminaire de Saint-Hyacinthe en septembre 1976. A son Alma mater, il s'emploie à faire exécuter des travaux de rénovation et d'embellissement à la crypte. Il décède au Centre hospitalier Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, le 6 juin 1979, âgé de 87 ans. Il était le doyen des évêques du Canada. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire.
Gérard Lusignan est né à Saint-Jude, le 30 juin 1897, de Prosper Lusignan, tailleur et sacristain, et de Léontine Nadeau. Après des études au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1910 à 1919, il entreprend des études théologiques au Grand Séminaire de Montréal de 1919 à 1922 et au Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1922-1923. Ordonné prêtre en la cathédrale de Saint-Hyacinthe, le 25 juillet 1923, par Mgr Raymond Marie Rouleau, il est par la suite professeur au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1923 à 1928, vicaire à la paroisse Saint-Pierre de Sorel de 1928 à 1936, aumônier des Sœurs de la Présentation de Marie à Saint-Hyacinthe de 1936 à 1940, curé de la paroisse de Saint-Thomas-d'Aquin de 1940 à 1954, curé de la paroisse de Saint-Hugues de 19.54 à 1972, vicaire forain de 1956 à 1968, nommé chanoine titulaire de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe le 4 octobre 1958. Retiré à Sainte-Rosalie à partir du 27 septembre 1972, il décède au Centre hospitalier Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe le 29 juillet 1979, âgé de 82 ans. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire.
Lambert Collette est né à Saint-Damase, le 17 mars 1908, fils d'Adalbert Collette, médecin, et de Pauline Cartier. Après des études au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1920 à 1928 et des études théologiques au Grand Séminaire de Montréal de 1928 à 1931 ainsi qu'à celui de Toronto, Ontario, en 1931-1932, il est ordonné prêtre en la chapelle du Séminaire de Saint-Hyacinthe, par Mgr Aidée Desmarais, le 21 mai 1932. Nommé vicaire à Saint-Dominique du 28 mai au 29 juin 1932, il est professeur au Séminaire de Saint-Hyacinthe de septembre 1932 à juillet 1935, vicaire à Saint-Hilaire de juillet à décembre 1935, à Farhnam de décembre 1935 à décembre 1936, à Notre-Dame de Granby de décembre 1936 à février 1950, desservant de West Shefford (Bromont) de février à avril 1950; curé de Clarenceville de 1950 à 1954, de Roxton Pond de 1954-1965, de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Sorel de 1965 à 1977, aumônier des Chevaliers de Colomb de Sorel à partir de 1968. Retiré au Séminaire de Saint-Hyacinthe, à partir du 13 juillet 1977, il décède le 19 janvier 1980, au Centre hospitalier Honoré-Mercier, âgé de 71 ans. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire.
L'Association Catholique de la Jeunesse Canadienne-Française - A.C.J.C. est fondée le 13 mars 1904. Ce regroupement est le résultat d'une campagne de propagande en faveur du drapeau Carillon Sacré-Cœur, « emblème spécial des Canadiens français ». Après avoir organisé une ligue sous l'égide des jésuites, M. Joseph Versailles, élève de philosophie du collège Sainte-Marie de Montréal, émet l'idée d'un congrès où la jeunesse pourrait exposer ses ambitions et ses commentaires sur son engagement à prendre dans les domaines sociaux et politiques. L'objet de la corporation est-il mentionné « est de former les jeunes gens à une vie de dévouement au service de l'Église et de la patrie canadienne et est d'assurer à ses membres un complément de formation personnelle au moyen de cercles d'études et de travailler au succès des entreprises d'utilité publique qui se rapporte à la charité, à l'éducation, aux questions morales, sociales nationales et économiques ». Un premier congrès a lieu le 25 juin 1904 à Montréal. Rapidement, l'association compte des cercles dans presque tous les diocèses de langue française et dans toutes les provinces sauf l'Île du Prince-Édouard et la Colombie-Britannique. Dès la fondation, l'association publie un périodique« Le Semeur » et de nombreuses brochures. L'Union régionale de l'A.C.J.C. de Saint-Hyacinthe est fondée le 30 juin 1916 afin de regrouper tous les cercles du diocèse de Saint-Hyacinthe. L'A.C.J.C. met fin à ses activités vers 1932, la Jeunesse Étudiante Catholique - J.E.C. drainant la majorité des membres actifs de l'A.C.J.C.
Maurice Lecomte est né à Saint-Sébastien d'Iberville, le 13 juin 1902, de Pierre Lecomte, cultivateur, et d'Antoinette Trudeau. Après des études au Séminaire de Saint-Jean-sur-Richelieu et des études théologiques au Grand Séminaire de Montréal de 1924 à 1928, il est ordonné prêtre en la cathédrale de Saint-Hyacinthe, par Mgr Fabien-Zoël Decelles, le 2 juin 1928. Auxiliaire et professeur au Séminaire de Saint-Hyacinthe de septembre 1928 à juillet 1943, en repos à Saint-Charles-sur-Richelieu en juillet 1943, puis à Saint-Boniface, Manitoba, jusqu'en 1950 et au presbytère d'Upton d'avril à juillet 1950, il est nommé aumônier du Juvénat Saint-Jean-Baptiste, à Philipsburg, de juillet 1950 à 1968. Retiré d'abord à ]'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe de 1968 à 1975, puis au Séminaire de Saint-Hyacinthe à partir de 1975, il décède au Centre hospitalier Honoré-Mercier, le 19 février 1985, âgé de 82 ans. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire.
Eucher Martel est né à Saint-Pie, le 15 mars 1895, de Zéphirin Martel, cultivateur, et de Victoria Laflamme. Après des études au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1909 à 1917 et au Grand Séminaire de Montréal de 1917 à 1920 et de Saint-Hyacinthe en 1920-1921, il est ordonné prêtre, à Saint-Pie, le 24 juillet 1921, par Mgr J.S. Hermann Brunault. Professeur au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1921 à 1927 et de 1928 à 1934, il étudie entre-temps à l'Université Laval de Québec en 1927-1928 où il obtient une licence ès Lettres. Assistant-directeur diocésain de l'Action catholique de 1934 à 1937, il est nommé curé de la paroisse du Précieux-Sang de Saint-Hyacinthe de 1937 à 1968, aumônier diocésain de la Ligue Ouvrière Catholique - L.O.C., de 1948 à 1951, camérier secret du pape Pie XII, le 11 août 1952, aumônier de la Villa des Frênes de Saint-Hyacinthe à partir de 1968, aumônier-fondateur diocésain de la Vie montante de 1973 à 1977. Il décède au Centre hospitalier Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, le 18 août 1979, âgé de 84 ans. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire.
Gaston Girouard est né à Saint-Thomas-d'Aquin, comté de Saint-Hyacinthe, le 26 novembre 1905, de Joseph Girouard, menuisier, et de Joséphine Blanchard. Après des études classiques en cours privés en 1925-1926 et en 1932-1933, au Séminaire de Saint-Victor de Beauce en 1926-1927, au Juniorat Montfortain de Papineauville en 1927-1928 puis au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1933 à 1935, il entreprend des études théologiques au Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1935 à 1939. Il est ordonné prêtre le 3 juin 1939 en la cathédrale de Saint-Hyacinthe par Mgr Fabien-Zoël Decelles. Infirmier et professeur au Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1939-1940, en repos l'année suivante, il va occuper diverses fonctions à l'évêché de Saint-Hyacinthe : cérémoniaire en 1941-1942, assistant chancelier en 1941-1944, secrétaire de 1944 à 1951, vice-postulateur de la cause de Mgr Louis-Zéphirin Moreau en 1947, aumônier des Sœurs de Sainte-Marthe à l'évêché de 1949 à 1955, chancelier du diocèse de 1951 à 1959, de 1965 à 1972 et en 1976-1977, vicaire général de 1957 à 1977, aumônier de l'Association des clercs servants du diocèse en 1959, directeur diocésain de l'Œuvre pontificale de Saint-Pierre- Apôtre en 1964, archiviste de 1972 à 1977, secrétaire particulier des évêques de 1977 à 1979. De plus, il est nommé camérier secret du pape Pie XII en 1949 et prélat d'honneur en 1954. Retiré au Séminaire de Saint-Hyacinthe à partir du 12 juillet 1979, il décède à l'Hôpital Notre-Dame de Montréal, le 9 janvier 1981, âgé de 75. Il est inhumé dans le cimetière de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Lucien Beauregard est né à La Présentation, comté de Saint-Hyacinthe, le 13 août 1901, d'Osias Beauregard, cultivateur, et d'Emma Blanchette. Après des études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1915 à 1923 et des études théologiques au Grand Séminaire de Montréal de 1923 à 1927, il est ordonné prêtre, en la cathédrale de Saint-Hyacinthe, par Mgr F.-Z. Decelles, le 11 juin 1927. Professeur de philosophie au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1927 à 1931, étudiant au Collège canadien à Rome de 1931 à 1933, d'où il revient licencié en philosophie de l'Angélique en 1933, il est de retour au Séminaire afin de poursuivre son enseignement de 1933 à 1939 pour occuper par la suite le poste de directeur spirituel des élèves de 1939 à 1940, puis de nouveau celui de professeur de 1940 à 1944. Vice supérieur du Séminaire de juin 1941 à novembre 1947, de nouveau directeur spirituel de juin 1944 à novembre 1947, il est nommé supérieur, directeur de l'Œuvre des vocations et vicaire forain de novembre 1947 à juin 1953. Il est nommé chanoine titulaire de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe le 2 avril 1948, prélat domestique du pape Pie XII le 14 janvier 1950, aumônier général de la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste de la province de Québec en 1955, supérieur du Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1958 à 1965, aumônier des Sœurs de la Présentation de Marie à leur maison provinciale de Saint-Hyacinthe de 1965 à 1970, aumônier des Sœurs de Sainte-Marthe au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1974 à 1976. Retiré d'abord au Séminaire de 1970 à 1976, puis à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe à partir du 22 mars 1976, il y décède, le 17 mars 1979, âgé de 77 ans. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire.
Michel Sarrazin est né à Nuits-sous-Baune, en Bourgogne, le 5 septembre 1659, fils de Claude Sarrazin, fonctionnaire, et de Madeleine de Bonnefoy. M. Sarrazin arrive en Nouvelle-France en qualité de chirurgien-major des troupes en 1685. Médecin du roi à Québec en 1697, il s'intéresse à la faune québécoise et prépare divers mémoires sur le castor, le rat musqué, le phoque, le porc-épic, des notes sur les pêcheries, les mines d'ardoise, les sources minérales, la fabrication du sucre d'érable et surtout d'abondantes observations sur la flore québécoise. Correspondant de l'Académie des Sciences de Paris (1699), Michel Sarrazin épouse Marie-Anne Hazeur, à Montréal, le 20 juillet 1712. Il reçoit ainsi, par alliance, une partie des seigneuries de Grande-Vallée et de !'Anse-de-l'Etang. Il meurt à Québec le 8 septembre 1734.
Le Comité paritaire des institutions religieuses et des fabriques paroissiales de la juridiction de Saint-Hyacinthe est fondé le 19 février 1945. Il a pour but, par l'établissement de conventions collectives, de surveiller et d'assurer l'observance des conditions de travail des employés des institutions religieuses et fabriques paroissiales du diocèse de Saint-Hyacinthe. Le Comité est composé de dix membres, dont cinq nommés par l'Association patronale des institutions religieuses et des fabriques paroissiales, partie de première part; et cinq nommés par les parties de deuxième part comme suit: quatre par le Syndicat National Catholique des employés des institutions religieuses de Saint-Hyacinthe et un par l'Association des infirmières catholiques du diocèse de Saint-Hyacinthe. En 1964, le nombre de membres est porté à douze. Le siège social de l'organisme se situe à Saint-Hyacinthe.
Fils de Louis Morin, cultivateur, et de Marie-Clarisse Sylvestre, Hector Morin est né le 29 décembre 1876 à Saint-Ours. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1890 à 1897 et théologiques au Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1897 à 1901. Il est ordonné prêtre le 22 septembre 1901 par Mgr Maxime Decelles. Professeur de mathématiques au Séminaire de 1901 à 1907, il étudie par la suite à l'université Grégorienne de Rome en Italie de 1907 à 1911, où il obtient son doctorat en théologie en 1911. Il revient au Séminaire et enseigne la philosophie de 1911 à 1916 et de 1917 à 1928 et les mathématiques en 1916-1917. En 1927-1929, il s'occupe de la reconstruction du Séminaire et de sa chapelle. En 1928, des problèmes de santé l'obligent à suspendre l'enseignement. Son repos forcé lui permet de se consacrer à la floriculture. Le 23 juillet 1955, il décède à l'hôpital Saint-Charles de Saint-Hyacinthe à l'âge de 78 ans. il est inhumé dans la crypte du Séminaire.
Les anciens du cours de 1930-1938 sont: Onésime Beauregard, Julien et Rosaire Benoit, Jean-Paul Beutin, Roger Bouvier, Jacques Cayer, Jean-Paul Chicoine, André Côté, Yvon Courchesne, Charles Domingue, Jean Duprat, Jean-Lévis Fortier, Charles-Auguste Frédette, Clément et Jean-Louis Gendron, Guy Girard, Antonio Gosselin, Alfred Guillotte, Gérard Jourdain, Albéric Labelle, Lucien Labessière, Jacques Lamoureux, Ernest Langevin, Fernand Larochelle, Charles-Henri Larose, Albert Lavallée, Hubert Lebrun, Montcalm Lemoine, Armand Leroux, Jean-Luc Manny, Philippe Martel (1930-1933), Charles-Auguste Messier, Pierre-Paul Mongeau, Gilles-Yvon Moreau, Roger Ouellette, Paul Palmer, Lucien Phénix, Adélard Plouff e, René Saint-Germain, Léon Sylvestre.
Né à Farnham, le 17 février 1915, Fernand est le fils de Israël Larochelle, marchand général et de Angélina Brouillette. Après des études primaires à l'école du village, il entreprend son cours classique au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1930 à 1938, ses études philosophiques et pré-théologiques au Séminaire de Philosophie de Montréal de 1938 à 1939 et ses études théologiques au Grand Séminaire de Sherbrooke de 1941 à 1943. Ordonné le 4 avril 1943 à Sherbrooke, il occupe les fonctions suivantes : vicaire à Ham-Nord de 1943 à 1944, puis à Sainte-Thérèse d'Avila, Sherbrooke en 1944, aumônier au sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir de 1944-1945, vicaire à La Patrie de février à septembre 1945, vicaire à la paroisse Immaculée-Conception de Sherbrooke de l945 à 1946, vicaire à ,Wotton de 1946 à 1947, vicaire à Weedon de 1947 à 1948, curé de Piopolis de 1948 à 1953, de Saint-Elie d'Orford de 1953 à 1963, curé de la paroisse Christ-Roi de Sherbrooke de 1963 à 1964, intervenant dans le Mouvement Monde Meilleur de 1964 à 1968, curé à Racine de 1968 à 1969, à Coaticook de 1969 à 1973, séjour à l'Institut Catholique de Paris de 1972 à 1973, curé de Beebe de 1973 à 1975 où il est terrassé par une attaque cardiaque le 9 octobre 1975. Obligé de prendre du repos à l'archevêché de Sherbrooke de novembre 1975 à mars 1976, il exerce de nouveau son ministère à titre d'auxiliaire à Saint-Jean-Baptiste de Sherbrooke de 1976 à 1977, pour se retirer au Séminaire de Saint-Hyacinthe de mai 1977 à juillet 1980. Après un cours stage à Granby de juillet 1980 à février 1981, il retourne au Séminaire de Saint-Hyacinthe de février 1981 à 1984. Toujours actif, il est demandé pour enseigner la spiritualité à l'Arche d'Alliance à Shawinigan d'octobre 1981 à avril 1982, pour résider par la suite au presbytère de Sainte-Brigide d'Iberville de septembre 1984 à août 1986, puis à Sillery chez les Sœurs Sainte-Jeanne d'Arc d'août 1986 à janvier 1993, à Québec chez les Pères du Très-Saint-Sacrement de janvier 1993 à 1995. En janvier 1995, il se retire définitivement au Séminaire de Saint-Hyacinthe. Il est l'auteur de plusieurs volumes : « Léon Pratte, visage humain et spirituel d'un prêtre de chez-nous », Montréal, Paulines, 1987, 279 p. ; « Une réponse d'amour, Thérèse Martin », Montréal, Paulines, 1989, 204 p.; « La dévotion mariale de monseigneur Louis-Zéphirin Morea, 1824-1901 », dans « Des Bienheureux au cœur marial », collectif, Sillery, (Aux sources mariales de l'Église canadienne, no 8), p. 64-76, « Heures inoubliables », (récit de voyage en Europe en 1950, congrès eucharistique de Sherbrooke en 1959, discours à la béatification de Mère d'Youville), dans « Bulletin du Mont Sainte-Anne » de Sherbrooke, 1959, pagination diverse. L'abbé Larochelle est décédé au Centre hospitalier Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe le 7 octobre 2001 , à l'âge de 86 ans. Il est inhumé dans sa paroisse natale, à Farnham.
L'Association Catholique de la Jeunesse Canadienne-Française- A.C.J.C. est fondée le 13 mars 1904. Promu par les jésuites de Montréal, le regroupement est le résultat d'une campagne de propagande en faveur du drapeau Carillon Sacré-Cœur, « emblème spécial des Canadiens français». Un premier congrès a lieu le 25 juin 1904 à Montréal. Rapidement, l'association compte des cercles dans presque tous les diocèses de langue française et dans toutes les provinces sauf l'Ile du Prince-Édouard et la Colombie-Britannique. L'Union régionale de l'A.C.J.C. de Saint-Hyacinthe est fondée le 30 juin 1916 afin de regrouper tous les cercles du diocèse de Saint-Hyacinthe. M. Ulric Boucher est élu président et la première convention régionale a lieu le 9 mai 1918. Il y a à ce moment cinq cercles affiliés : Girouard au Séminaire, Benoit XV et Montalembert de Saint-Hyacinthe, Bernard à Sorel, Richelieu à Saint-Aimé et Saint-André à Acton V ale. Le cercle Christ-Roi est formé en juin 1929. L'A.C.J.C. met fin à ses activités vers 1932, la Jeunesse Étudiante Catholique- J.E.C. drainant la majorité des membres actifs de l'A.C.J.C.
Collection de partitions musicales regroupées à travers le temps par le service d'archives du Séminaire de Saint-Hyacinthe, au fil de dons d'archives par différents donateurs.
Paul Morin est né à Saint-Jude le 4 avril 1897, fils de William Morin, médecin, et d’Aline Lescault. Élève du Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1911 à 1919, il poursuit ses études à la faculté de médecine de l'Université Laval à Montréal. Il y obtient un doctorat et est admis à la pratique de la chirurgie en juillet 1924. Il va immédiatement parfaire ses études auprès des maîtres de cette discipline dans différents hôpitaux en Europe. De retour à Saint-Hyacinthe, il forme avec son père et ses frères Jean et Jules le bureau des docteurs Morin. Pratique ses premières interventions chirurgicales dans l'ancien hôpital Saint-Charles, en 1930, tout le corps médical de Saint-Hyacinthe s'installe dans le nouvel hôpital Saint-Charles sur le boulevard Laframboise. Les docteurs Jean et Paul Morin contribuent largement au développement de l'hôpital. En 1937, Paul Morin est nommé coroner et s’occupe entre autres du dossier de l’incendie du Collège du Sacré-Cœur en 1938, mais il démissionne de ce poste l’année suivante. En 1957, il est nommé administrateur et directeur-médical de la compagnie d'assurance La Survivance jusqu’à sa retraite. Durant l’été, il se repose à son chalet de Notre-Dame-de-Pontmain, au sud de Mont-Laurier, avec son frère l’abbé William Morin et leurs amis. Dans ses temps libres, il pratique la poésie, le dessin, la caricature, et surtout la peinture, laissant une collection de ses toiles au Séminaire en plus de ses archives et sa bibliothèque. D’ailleurs, le Séminaire a largement bénéficié des services professionnels du docteur Paul Morin car, de 1956 à 1962, il succède à son frère Jean et au docteur Gabriel Deslauriers comme médecin du Séminaire, prodiguant ses soins aux prêtres et aux élèves. Paul Morin décède le 15 mars 1985 au Centre hospitalier Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, sans descendants, ne s’étant jamais marié. Il est inhumé au cimetière de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe.
Napoléon Maynard est né à Notre-Dame de Saint-Hyacinthe, sur le territoire actuel de Saint-Thomas-d'Aquin, le 15 septembre 1884, d'Octave Maynard, cultivateur, et de Louise Gauvin. Ancien du Séminaire de Saint-Hyacinthe du cours 1899-1907, il entreprend des études théologiques au Grand Séminaire de Montréal, moins la dernière année au Séminaire de Saint-Hyacinthe, où il est ordonné par Mgr A.-X. Bernard, le 25 juillet 1911. Par la suite, il occupe les postes suivants : professeur au Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1911-1912, vicaire à Saint-Liboire de septembre 1912 à décembre 1915, à Notre-Dame de Granby de décembre 1915 à octobre 1916, à Saint-Simon de Bagot d'octobre 1916 à septembre 1917, à Saint-Hugues de septembre 1917 à avril 1918, à Saint-Théodore d'Acton d'avril à août 1918, desservant à Saint-Barnabé-Sud d'août à octobre 1918, aumônier du collège du Sacré-Cœur à Saint-Hyacinthe en octobre-novembre 1919, assistant-directeur de l'Action sociale catholique agricole de septembre 1919 au 29 janvier 1920, encore aumônier de l'Académie du Sacré-Cœur à Sorel du 29 janvier à septembre 1920, vicaire à L'Ange-Gardien de Rouville de septembre 1920 à février 1923, à Iberville de février 1923 au 28 septembre 1924, curé de Saint-Joachim de Shefford du 28 septembre 1924 à février 1933, où en 1932 il a relevé l'église de ses cendres, curé de Roxton Pond de février 1933 à septembre 1942, de Roxton Falls de 1942 à octobre 1954. Retiré à Saint-Hyacinthe, il y décède à l'hôpital Saint-Charles, le 3 octobre 1964. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire.
Fils de Henri Sanschagrin, chef de gare, et de Léontine Chevron, Albert Sanschagrin est né le 5 août 1911 à Saint-Tite. Il est l'aîné de dix enfants. Il fait ses études à l'école paroissiale de Saint-Tite dirigée par les Frères de Saint-Gabriel de 1917 à 1924, au Juniorat des Oblats à Ottawa de 1924 à 1930, au Noviciat des Oblats à Ville Lasalle en 1930, au Scolasticat des Oblats à Richelieu de 1932 à 1934 et au Scolasticat des Oblats de 1934 à son ordination, le 24 mai 1936, à Sainte-Agathe-des-Monts par Mgr Eugène Limoges. En 1939, il est nommé aumônier adjoint à la Centrale jociste où il fonde le service de « Préparation au mariage ». En 1947, il va au Chili pour prêter main-forte à l'Action catholique et à la Jeunesse ouvrière catholique de ce pays, il y établit aussi une mission pour sa Congrégation en 1949. En 1951, il contribue à la fondation des missions en Bolivie et au Surinam. Il est nommé supérieur provincial des Oblats de l'Est du Canada en 1953, coadjuteur d'Amos le 14 août 1957 et ordonné évêque le 14 septembre de cette même année à l'église du Sacré-Cœur d'Ottawa. Il est l'évêque coadjuteur d'Amos de 1957 à 1967, puis il est nommé évêque de Saint-Hyacinthe du 27 juillet 1967 au 18 juillet 1979, succédant ainsi à Mgr Arthur Douville. De 1962 à 1965, Mgr Sanschagrin participe activement aux quatre sessions du Concile Vatican II. Il poursuit l'application des principes du Concile Vatican II dans son diocèse. Il encourage également les vocations et les missions. Il fut président de la Commission épiscopale canadienne d'aide à l'Amérique latine. Il est aussi président au niveau provincial et secrétaire au niveau national du comité mixte chargé des relations Evêques-Religieux, en plus d'être président du comité spécial pour le rétablissement du diaconat permanent au Canada. Mgr Sanschagrin est décédé le 2 avril 2009 à l'âge de 97 ans et sa dépouille se retrouve dans la crypte à la chapelle des anciens évêques de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe.
L'abbé Clément Gendron est né à Saint-Hugues dans le comté de Bagot le 31 décembre 1913, d'Alexandre Gendron, cultivateur, et d'Anne-Marie Fontaine. Il a fait ses études classiques à Chambly-Bassin et au Séminaire de Saint-Hyacinthe, de 1931 à 1938, sa théologie au Grand Séminaire de Montréal, de 1938 à 1942, moins la première année de Everell, Québec. Il est ordonné au Séminaire de Saint-Hyacinthe, par Mgr Arthur Douville, alors évêque coadjuteur de Saint-Hyacinthe, le 30 mai 1942, sa première messe fut célébrée à Saint-Hugues le 31 mai 1942, accompagné du chanoine Jean Robin. Il a été auxiliaire et professeur au Séminaire de Saint-Hyacinthe de septembre 1942 à août 1944, vicaire à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe, de août 1944 à avril 1951, à Saint-Césaire de avril 1951 à juillet 1954, à Saint-Gabriel Lalemant à Sorel de septembre 1954 à septembre 1957, à Upton de septembre 1957 à octobre 1961. Desservant et administrateur à Saint-Athanase d'Iberville de octobre 1961 à juillet 1962. Par la suite, il est nommé curé à Sainte-Cécile de Milton de juillet 1962 à juillet 1968, à Marieville de juillet 1968 à juillet 1972 et à Sainte-Madeleine de 1972 à 1979. Ces autres nominations sont : aumônier diocésain de la J.I.C.F. (Jeunesse indépendante catholique féminine) de 1948 à 1951, aumônier régional des Lacordaires, région de Sorel, en février 1956, confesseur extraordinaire des Sœurs de la Charité de Namur, Sorel en juin 1955, aumônier du Pavillon Iberville Inc., hôpital privé, en 1961, fait Chevalier de Colomb, 3e degré en 1951 à la salle Notre-Dame de Saint-Hyacinthe et 4e degré le 9 mai 1965 à l'Hôtel Sheraton à Montréal. Il se retire en 1979 au Séminaire de Saint-Hyacinthe. Durant sa retraite, l'abbé Gendron à exercé du ministère paroissial dans le diocèse de Saint-Hyacinthe et a réalisé de nombreux travaux de généalogie. Il décède au Séminaire de Saint-Hyacinthe, le 21 août 1998. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire.
Jean-Paul Morin est né à Saint-Ours, le 29 septembre 1909, de Georges Morin, cultivateur puis marchand, et d'Eva Tremblay. Après des études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1921 à 1929, il entreprend sa cléricature au Grand Séminaire de Montréal de 1929 à 1933 où il est licencié en théologie de l'Université de Montréal. Ordonné en la chapelle du Séminaire de Saint-Hyacinthe, par Mgr Aldée Desmarais, le 10 juin 1933, il occupe par la suite les postes suivants : professeur au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1933 à 1937, étudiant en Lettres à l'Université de Montréal de 1937 à 1939, de nouveau professeur au Séminaire de 1939 à 1949, étudiant en Lettres à l'Institut catholique et à La Sorbonne à Paris en France en 1949-1950, professeur au Séminaire de 1950 à 1966, vice-supérieur de l'institution de 1956 à 1966, aumônier général de la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste de la province de Québec de 1958 à 1966, curé de la paroisse Saint-Gabriel-Lalemant de Sorel de 1966 à 1981, aumônier de l'Assemblée Jacques-Cartier des Chevaliers de Colomb du 4e degré de Sorel de 1980 à 1985, chanoine titulaire de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe le 27 mai 1981. Retiré au Séminaire le 14 juillet 1981, il décède à la Fraternité sacerdotale du Lac Supérieur, le 13 septembre 1987, à l'âge de 77 ans. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire.
Bénoni-Joseph Hébert est né à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 30 mars 1884. Il est le fils de Joseph Hébert, contremaître à la Canadian Potery, et de Rosalie Labonté. Après des études chez les Frères des Écoles Chrétiennes de 1895 à 1902, Bénoni-Joseph est à l'emploi de Joseph-Laurent Pinsonnault, membre d'une famille bien connue de photographes dont l'un des studios est situé à Saint-Jean. Le jeune Hébert met son talent de calligraphie à exécution en ornant les montages photographiques puis il s'occupe du développement et de la prise de photographies. En 1904, il se retrouve au Studio Pinsonnault de Sherbrooke. Il gère le commerce pendant que son patron produit des cartes postales dans une partie de la province. Au retour de ce dernier, il perd son emploi et cherche une solution de rechange. Il s'installe alors à Saint-Hyacinthe où sept photographes exercent déjà. En septembre 1905, il fait l'acquisition du Studio Archambault, situé sur la rue Des Cascades. En peu de temps, il atteint la notoriété et devient le photographe attitré du clergé maskoutain, des écoles et de la municipalité. Il est surtout spécialisé dans le portrait individuel ou collectif. En 1912, toutes les photographies d'une publication sur Saint-Hyacinthe proviennent du Studio B.J. Hébert. En 1915, il se porte acquéreur de l'édifice situé à l'angle sud-ouest de la rue Des Cascades et de l'avenue Sainte-Anne. À l'époque, il fait l'acquisition du matériel d'éclairage électrique pour le studio. Bénoni-Joseph a épousé en 1909, à Saint-Jean-sur-Richelieu, Éva Mercier. Le couple aura dix enfants dont Jeanne qui colore au pochoir d'admirables portraits et Jean son successeur. Bénoni-Joseph est décédé en février 1957. Jean Hébert est né le 15 décembre 1906, à Saint-Hyacinthe. Enfant, il fréquente l'école Raymond et un peu l'Académie Girouard. Dès 1921, il prend ses premiers portraits et se familiarise avec le métier. Il fait aussi ses premiers essais de photographies extérieures. Durant la Crise économique de 1929 à 1938, la concurrence s'éclipse et le Studio B.J. Hébert reste le seul commerce du genre à Saint-Hyacinthe. Le Studio Hébert ferme ses portes en 1986. Jean Hébert a épousé en 1950, Cécile Martel, à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe. Il est décédé le 2 janvier 2001, âgé de 94 ans, ses funérailles ont eu lieu à la paroisse Sacré-Cœur de Saint-Hyacinthe.
Samuel Lemoine est né à Saint-Robert, comté de Richelieu, le 20 février 1914, de Félix Lemoine et de Marie-Anne Cournoyer. Après des études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1927 à 1935 et des études théologiques au Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1935 à 1939, il est ordonné prêtre le 3 juin 1939, par Mgr F.-Z. Decelles, à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe. D'abord auxiliaire au Séminaire de Saint-Hyacinthe de septembre 1939 à septembre 1941, en repos à l'Hôpital Saint-Charles et à Saint-Robert de septembre 1941 à janvier 1942, il est professeur au Séminaire de Saint-Hyacinthe de janvier 1942 à juin 1947, puis directeur des élèves de 1947 à 1959, Supérieur de 1959 à 1965, curé de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe de 1965 à 1976, aumônier des sœurs de la Charité à la Métairie depuis 1946 et à la résidence Marguerite d'Youville depuis 1976. Il est vicaire forain de Saint-Hyacinthe de 1959 à 1969, prévôt du chapitre de la Cathédrale depuis septembre 1967, directeur de l'Œuvre des vocations du diocèse à partir de 1965, directeur de l'éducation à partir de 1963, membre du conseil de vigilance à partir de 1966. Nommé chanoine titulaire de la Cathédrale le 4 octobre 1958 puis prélat d'honneur à la maison pontificale le 25 novembre 1961, il est retiré à la Métairie puis au Séminaire de Saint-Hyacinthe depuis 1997.
Paul Marc-Aurèle est né à Saint-Hyacinthe le 9 février 1914, d'Émile Marc-Aurèle et d'Arsélia L'Heureux. Après des études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1926 à 1934, il se consacre aux études théologiques au Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe pour être ordonné en la Cathédrale de Saint-Hyacinthe, par Mgr F.-Z. Decelles, le 11 juin 1938. Professeur au Séminaire de Saint-Hyacinthe de septembre 1938 à août 1940, assistant-secrétaire et cérémoniaire à l'évêché d'août 1940 à septembre 1941, il est étudiant en droit canonique à l'Université d'Ottawa de septembre 1941 à juin 1944 où il obtient sa licence en 1943 et son doctorat l'année suivante. Assistant-chancelier et cérémoniaire à l'évêché de Saint-Hyacinthe de juin 1944 à juin 1947, il est nommé professeur au Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe de juin 1947 à 1965 et procureur de l'institution durant une année d'octobre 1951 à juillet 1952. Il laisse alors son poste pour devenir consulteur canonique à la chancellerie, pour remplacer, en partie, le chancelier nommé à d'autres fonctions à Montréal. Nommé chanoine titulaire et secrétaire du chapitre de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe en 1976, il le demeure jusqu'en 1982. Il fait partie du Tribunal ecclésiastique régional de Montréal de 1947 à 1979. De 1968 à 1979, il y travaille à temps plein comme adjoint judiciaire. Résidant à l'évêché de Saint-Hyacinthe après 1968, il habite plus tard dans un appartement à Montréal pour y travailler ses causes. Retiré au Séminaire de Saint-Hyacinthe, il y décède le 24 décembre 1989. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire.
Pierre-Paul Mongeau est né au Sainte-Anne de Sorel, le 25 février 1918, fils d'Arthur Mongeau, navigateur, et d'Adma Desmarais. Ancien du cours 1930-1938 du Séminaire de Saint-Hyacinthe, il est étudiant en théologie au Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1938 à 1942 et est ordonné prêtre, par Mgr Arthur Douville, le 30 mai 1942, à la chapelle du Séminaire de Saint-Hyacinthe. Vicaire à la Cathédrale et maître des cérémonies de juillet 1942 à septembre 1944, il retourne aux études en s'inscrivant en théologie à l'Université Laval de Québec, de septembre 1944 à juin 1946, d'où il revient docteur en théologie. Professeur au Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe de septembre 1946 à janvier 1948, en repos à Montréal et à l'évêché de Saint-Hyacinthe de janvier à septembre 1948, il est nommé aumônier diocésain de la JOC de septembre 1948 à juillet 1949, aumônier diocésain de la JECF de juillet 1949 à juillet 1950, vicaire à la Cathédrale et cérémoniaire de juillet 1950 à juillet 1953. Il occupe par la suite les postes suivants : vicaire à Saint-Pierre de Sorel de 1953 à 1960, aumônier à l'hôpital Richelieu et vicaire économe« in spiritualibus » à Saint-Pierre de Sorel de 1957 à 1960, vicaire substitut à Saint-Alexandre de janvier à mars 1960, vicaire substitut à Sainte-Madeleine de mars à juillet 1960, vicaire à Saint-Pie de juillet 1960 à juillet 1962, curé de Stanbridge Est, de juillet 1962 à juillet 1965, curé à Saint-Antoine- sur-Richelieu, de juillet 1965 à octobre 1967, curé de McMasterville d'octobre 1967 à juillet 1983 et aviseur moral à la Légion canadienne section « Dion » Beloeil McMasterville et pour le district de la Rive Sud, président de la zone pastorale de la région de Beloeil de mars 1971 à juillet 1983, curé de Sainte-Hélène de Bagot à partir de juillet 1983, il décède au Centre hospitalier Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, le 10 octobre 1992, à l'âge de 74 ans. Il est inhumé à Sainte-Hélène. Il a reçu la médaille « Pro ecclesia et pontifice » le 6 août 1952.
Fils de Joseph-Pierre Leclaire, comptable, et d'Anna Laroche, Jean-Charles Leclaire est né le premier janvier 1911, à Saint-Joseph-de-Sorel. Il fait ses études primaires à Sorel d'abord chez les Sœurs de Saint-Joseph, puis chez les Frères de la Charité à l'Académie du Sacré-Cœur. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1924 à 1931 et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal de 1931 à 1935. Il est ordonné le 15 juin 1935, à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe. Entre 1935 et 1938, il étudie au Collège canadien à Rome et à l'Institut Pontifical Biblique de Jérusalem, d'où il revient licencié en Écriture Sainte. De septembre 1938 à juin 1946, il enseigne au Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe. Il est nommé vicaire général de Saint-Hyacinthe le 15 août 1946, puis prélat domestique le 30 octobre 1946. Il devient directeur général de l'Action catholique et de l'Action sociale dans le diocèse du 7 octobre 1947 à 1954. On le retrouve aux Conversations sociales catholiques tenues à Toronto en février 1944 et à la Havane en janvier 1946. En 1945, il est l'initiateur des Journées sacerdotales d'études sociales, puis il fonde l'École d'action ouvrière du diocèse de Saint-Hyacinthe pour la formation chrétienne des militants syndicaux. Il s'implique aussi dans plusieurs mouvements sociaux : à la Commission sacerdotale d'Etudes sociales où il est président du 13 février 1948 jusqu'en 1962 ; au Département l'Action sociale, section française, de la Conférence catholique canadienne, où il est directeur du 13 octobre 1948 à 1954; au Secrétariat national d'Action sociale dont il est membre de 1950 à 1957. En outre, il contribue au règlement de la grève de l'amiante à Asbestos en 1949. Il est nommé Protonotaire apostolique le 11 août 1952, chanoine titulaire le 5 septembre 1957 et il devient curé de la paroisse Saint-Pierre de Sorel, le 29 septembre 1957. Durant son mandat, il effectue avec les membres de la Fabrique, une importante rénovations de l'église, classée monument historique en 1960. Il se retire le 15 juillet 1986, d'abord au Lac Supérieur dans le comté de Labelle (Laurentides) et emménage graduellement au Séminaire de Saint-Hyacinthe entre le premier novembre 1991 et le 28 octobre 1993, date à laquelle il s'établit définitivement au Séminaire. Il est l'auteur, seul ou en collaboration, de plusieurs documents traitant de différentes questions sociales. Il décède, après un temps de maladie, le 17 janvier 1998, à Saint-Hyacinthe, âgé de 87 ans. Il est inhumé à Sorel. Il a été mêlé aux changements survenus après le concile Vatican II, aux visites des délégués apostoliques, au règlement de la « faillite » de La Bonne Chanson, aux grèves de Sorel et d'Asbestos. Il s'est occupé des souscriptions en faveur de l'Université de Montréal pour laquelle il a reçu avec le juge Victor Chabot, un doctorat honorifique, puis celle tenue à travers tout le diocèse, afin de défrayer les coûts de construction du Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1952.
Léo Saint-Laurent est né à Saint-Simon de Bagot le 18 novembre 1918. Fils de Rosaire Saint-Laurent, boucher, et de Marie-Louise Desrosiers, il fait ses études primaires au couvent des Sœurs de Saint-Joseph à Saint-Simon. Au Séminaire de Saint-Hyacinthe il complète ses études classiques de 1930 à 1941. Après avoir terminé ses études théologiques au Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1941 à 1945, destiné d'abord à la prêtrise, la maladie force monsieur Saint-Laurent à occuper différentes autres responsabilités au Séminaire de Saint-Hyacinthe. Il devient portier de 1948 à 1954 et météorologue pour le compte du Bureau météorologique de Québec, comme substitut de 1948 à 1966 et responsable de 1966 à 1979. Secrétaire de l'Œuvre des vocations de 1954 à 1966, assistant-procureur de 1966 à 1983, responsable de l'Association des Anciens de 1954 à 1989, serrurier pendant 35 ans et relieur de puis 1979. Monsieur Léo Saint-Laurent est retraité au Séminaire de Saint-Hyacinthe depuis 1983. Pendant ses vacances, il a fait de nombreux voyages sur les cinq continents. Passionné d'histoire et de généalogie, ce membre de la Société généalogique canadienne-française et de la Société d'histoire régionale de Saint-Hyacinthe a publié une trentaine de livres à la suite de ses nombreuses recherches généalogiques dans certaines paroisses environnantes de Saint-Hyacinthe, principalement à l'intérieur des comtés de Bagot, Richelieu et Saint-Hyacinthe.
Léa Sansoucy est né à Saint-Jude, le 6 avril 1902, de François Sansoucy, menuisier, et de Héloïse Lemay. Après des études élémentaires dans sa paroisse natale, il est admis au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1916 à 1924 où il complète son cours classique. En septembre 1924, muni d'un Baccalauréat ès-arts de l'Université de Montréal, il se dirige au Grand Séminaire de Montréal pour des études théologiques, institution qu'il fréquente de 1924 à 1928. Il reçoit l'ordination sacerdotale le 2 juin 1928, des mains de Mgr F.-Z. Decelles, en la Cathédrale de Saint-Hyacinthe. Il est aussitôt professeur au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1928 de 1934. Étudiant en Lettres à l'Université de Montréal de 1934 à 1936, il y obtient la Licence-ès-Lettres. Dès lors, s'ajoutent des études complémentaires, à l'Université Catholique de Paris et à la Sorbonne en 1936-1937 avec un voyage d'études en Grèce au printemps de 1937. Rappelé d'urgence à son Alma Mater, il est nommé préfet des études du Séminaire, fonction qu'il n'avait aucunement désirée et avec laquelle il devait s'identifier pendant seize ans, de juin 1937 à septembre 1953. Il est alors membre du Conseil de la Faculté des Arts à l'Université de Montréal et secrétaire de cette Faculté de 1953 à 1965. De juin 1965 au 1er juillet 1978, il occupe le poste de supérieur de cette institution à laquelle il a consacré le meilleur de lui-même. À l'époque, les collèges classiques vivaient une période de changements et d'adaptations. Tout était remis en cause. Homme de l'heure, Mgr Sansoucy a su faire face à la situation et donner le coup de barre dans la bonne direction. Il travaille à l'implantation de la structure pluraliste qui régit l'école du Séminaire depuis 1972. Cette structure se concrétise par l'intégration du conseil scolaire, composé de parents et d'employés qui prennent part à l'administration. Malgré son âge avancé, Mgr Léo Sansoucy vaque encore quotidiennement à ses fonctions d'archiviste et de bibliothécaire du Séminaire de 1970 à 1987. On lui doit d'avoir opéré un changement radical dans le classement et la conservation des archives, surtout d'avoir permis la création de répertoires et d'instruments de recherche. Il a fait partie de l'équipe qui a permis la relance de la Société d'Histoire régionale de Saint-Hyacinthe, en septembre 1971. Notons qu'il a été secrétaire-trésorier de cette société. Vice-supérieur du Séminaire de 1978 à 1987, nommé chanoine titulaire du Chapitre de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe en 1966 puis chanoine honoraire en 1982, nommé prélat d'honneur par le Pape Paul VI en 1978, il décède au Centre hospitalier Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, après une courte maladie pulmonaire, le 21 mai 1987. Il est âgé de 85 ans. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire.
Fils de Félix Saint-Martin, ingénieur, et de Aurélie Péloquin, Félix Saint-Martin est né le 6 août 1877 à Saint-Joseph-de-Sorel. Il fait des études à l'Académie du Sacré-Cœur de Sorel. Il épouse Blandine Goulet à Saint-Joseph-de-Sorel le 25 janvier 1904. De ce mariage naît 10 enfants. Félix Saint-Martin est navigateur et ingénieur-mécanicien. En 1921, il devient propriétaire de la traverse sur la rivière Richelieu entre Sorel et Saint-Joseph-de-Sorel. Conseiller à la municipalité de Saint-Joseph-de-Sorel, il est élu maire de cette localité de 1929 à 1931. Marguiller de la paroisse de Saint-Joseph-de-Sorel de 1936 à 1940, il décède à l'hôpital Hôtel-Dieu de Montréal le 16 octobre 1940, à l'âge de 63 ans. Il est inhumé au cimetière de Saint-Joseph-de-Sorel.
Fils de Félix Saint-Martin, ingénieur, et de Blandine Goulet, Louis-Philippe Saint-Martin est né le 20 juin 1917, à Saint-Joseph de Sorel. Il fait son cours classique au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1929 à 1936 et sa théologie au Grand Séminaire du même endroit de 193 7 à 1941. Il est ordonné prêtre le 7 juin 1941, à Saint-Hyacinthe. D'abord enseignant au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1941 à 1946, il retourne aux études en Lettres-pédagogie à l'Université de Montréal de 1946 à 1948 et en Lettres à l'Institut Catholique de la Sorbonne à Paris en 1948-1949 et décroche une licence en Lettres. Il revient ensuite enseigner au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1949 à 1953, puis il est nommé préfet aux études de 1953 à 1962 dans cette même institution. Par la suite, il devient vice-doyen de la Faculté des arts de l'Université de Sherbrooke de 1962 à 1965, puis secrétaire de la Faculté des arts de l'Université de Montréal de 1965 à 1970. Il effectue ensuite un stage d'études en Sciences religieuses à la Formation permanente du Clergé de l'Institut Catholique de Paris en 1970-1971. Il revient à Saint-Hyacinthe comme curé des paroisses Sainte-Eugénie de Douville de 1971 à 1973 et Saint-Jude de 1974 à 1984. Il se retire au Séminaire en 1984 et occupe les fonctions de vice-supérieur, archiviste et bibliothécaire de 1987 à 1989. Il décède le 29 mai 1995 à l'hôpital Honoré-Mercier, à l'âge de 77 ans. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe.
Fils de Félix Saint-Martin et de Blandine Goulet, Joseph-Alfred Saint-Martin, est né le 7 septembre 1914, à Saint-Joseph-de-Sorel. Il fait son cours classique de 1927 à 1935 au Séminaire de Saint-Hyacinthe et ses études théologiques de 1935 à 1939 au même endroit. Il est ordonné prêtre le 3 juin 1939 à Saint-Hyacinthe. Il enseigne d'abord au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1939 à 1941, puis il est nommé vicaire à Saint-Damase en 1941 et à Saint-Pierre-de-Sorel de 1941 à 1952. Il est ensuite aumônier diocésain de la Jeunesse Ouvrière Catholique en 1952-1953 et assistant-aumônier à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe de 1952 à 1957. Il est successivement curé des paroisses Saint-Pierre-de-Véronne à Pike River de 1957 à 1962, Sainte-Anne-de-Sorel de 1962 à 1972 et Saint-Hugues de 1972 à 1979. Le 18 juillet 1979, il prend sa retraite au Séminaire de Saint-Hyacinthe. Il décède à l'Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, le 27 février 1995, à l'âge de 80 ans. Il est inhumé dans le cimetière de la paroisse de Saint-Joseph de Sorel.
Fils de Xavier Lussier, pomiculteur et acériculteur, et de Eveline Davignon, Zoïle Lussier est né le 7 mai 1909 à Saint-Michel de Rougemont. Après ses études élémentaires dans sa paroisse natale, il entre au Séminaire de Saint-Hyacinthe pour son cours classique de 1922 à 1930. Il obtient une Licence en théologie à la fin de ses études théologiques au Grand Séminaire de Montréal, cours 1930-1934. Il est ordonné prêtre à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe, le 26 mai 1934. Professeur au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1934 à 1941, monsieur l'abbé Zoïle Lussier est nommé vicaire de 1941 à 1948 dans trois paroisses : Immaculée-Conception de Saint-Ours de 1941 à 1943, Saint-Joseph-de-Sorel de 1943 à 1944 et Saint-Eugène de Granby de 1944 à 1948. Muté à la Maison provinciale des Soeurs de la Présentation de Marie à Saint-Hyacinthe en tant qu'aumônier de 1948 à 1955, il devient curé à partir de 1955 jusqu'à sa retraite en 1974. Il est successivement curé des paroisses de Sainte-Victoire de Sorel de 1955 à 1960, Saint-Antoine-sur-Richelieu de 1960 à 1965, Saint-André d'Acton Vale de 1965 à 1972 et Saint-Ignace-de-Standbridge de 1972 à 1974. Retraité à Granby de 1974 à 1976, au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1976 à 1987 et à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe de 1987 à son décès le 12 décembre 1991, à l'âge de 82 ans. Il est inhumé dans la crypte du Séminaire de Saint-Hyacinthe.
Quatre religieuses de la communauté des Soeurs de la Charité de Montréal fondent à Saint-Hyacinthe la communauté des Soeurs de la Charité de Saint-Hyacinthe en 1840 afin de s'occuper d'une maison de charité. Les Soeurs de la Charité, communément appelées les Soeurs Grises, ont oeuvré dans trois domaines d'activités à Saint-Hyacinthe de 1840 à 1977. Domaine hospitalier : Hôtel-Dieu, 1840-1966; Établissement d'un orphelinat, 1870-1961; Maison Saint-Benoît et Saint-Isidore pour malades contagieux, typhoïde et variole, 1885-1886; Département Saint-Roch pour contagieux, 1895-1962; Retraite Saint-Antoine pour prêtres retraités, 1901-1924; Refuge Saint-Amable pour malades psychiatriques, 1906-1977; Retraite Saint-Bernard pour prêtres malades, 1924-1966; Fondation de l'hôpital Saint-Charles, 1902-1964; Direction de l'École d'infirmières, 1925-1968. Domaine éducatif : École des Saints-Anges, Académie Prince, 1854-1882; École de La Providence, 1859-1862; École des Saints-Innocents, succursale de l'Académie Girouard, 1868-1876. Domaine social : Visites à domicile, veillées mortuaires à domicile, visites des prisonniers, 1849-1955; Ouvroir Sainte-Geneviève, 1864-1963. De nos jours, les Soeurs de la Charité de Saint-Hyacinthe se dévouent dans des équipes de pastorales, de bénévolat ou d'aide aux malades. Dispersées aux États-Unis, en Haïti, au Manitoba, à Sorel et à Sherbrooke, ces religieuses relèvent de la Maison-mère de Saint-Hyacinthe.
Né à Saint-Jude, le 22 avril 1918, fils de Joseph Dupuis, cultivateur et de Marie-Anne Allard, Gérard Dupuis fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1932 à 1941 et sa pré-théologie au Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1941 à 1946. Il est ordonné prêtre, le 15 juin 1946, à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe par Mgr Conrad Chaumont. Tout d'abord auxiliaire et professeur au Séminaire de Saint-Hyacinthe de septembre 1946 à septembre 1950, il est ensuite professeur au Collège Mgr Prince à Granby de septembre 1950 à septembre 1953. Il est conjointement professeur au Séminaire de Saint-Hyacinthe, de septembre 1953 à septembre 1959, et prédicateur de l'Oeuvre diocésaine des Vocations, de septembre 1954 à septembre 1959. Il étudie par la suite à l'Université Laval à Québec, de septembre 1959 à mai 1962, en Orientation scolaire et professionnelle, d'où il sort Bachelier en Psychologie et Licencié en Orientation scolaire et professionnelle. Il est par la suite conseiller en orientation scolaire et professionnelle au Séminaire de Saint-Hyacinthe, de septembre 1962 à septembre 1979, de même qu'au Cégep de Saint-Hyacinthe, de septembre 1968 à juillet 1974. Il devient vice-supérieur au Séminaire de Saint-Hyacinthe, du 29 juillet 1968 au 1er juillet 1978, puis il est nommé Supérieur le 1er juillet 1978. Il est membre du conseil d'administration du Séminaire de Saint-Hyacinthe à partir du 29 juillet 1968, et il est responsable des vicaires dominicaux, du 12 juin 1975 au 5 mai 1978. Il est nommé chanoine titulaire du chapitre de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe, le 27 mai 1981, puis prélat d'honneur de la Maison pontificale, le 27 décembre 1984. Il s'est retiré au Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1990. Il décède à Saint-Hyacinthe le 14 juin 2007, à l'âge de 89 ans. Les funérailles ont lieu lundi le 18 juin 2007 en la Chapelle du Séminaire de Saint-Hyacinthe suivies de la mise en crypte au même endroit.
Née à Saint-Hyacinthe, le 19 décembre 1909, fille de Rémi Daigle, maître-boucher, et d'Adéline Bonin, Jeanne Daigle étudie chez les Soeurs de Saint-Joseph, ainsi que chez les Soeurs de La Présentation de Marie, où elle obtient son diplôme supérieur d'enseignement à l'âge de 16 ans, en 1925. Elle suit quelques cours par correspondance à l'Université d'Ottawa, en sciences ainsi qu'en littérature. Elle obtient aussi un lauréat en musique (piano, violon et orgue) au Dominion College of Music. Par la suite, elle fonde une école privée du nom de « Ecole Daigle », et y enseigne jusqu'en 1965, pour ensuite devenir professeur de français à l'Institut de technologie agricole et alimentaire de Saint-Hyacinthe de 1965 à 1977. Alors que les bibliothèques paroissiales sont encore en fonction, elle est responsable de la bibliothèque de la paroisse Notre-Dame de Saint-Hyacinthe située au Centre Notre-Dame. S'intéressant à l'écriture, elle rédige de nombreux textes pour la radio, entre autres pour des émissions enfantines à CKAC, Radio-Collège de Radio-Canada de 1945 à 1948 et CKBS. De plus, elle écrit, en tant que journaliste, pour l'Action Catholique, Paysana, Le Courrier et Le Clairon de Saint-Hyacinthe, La Voix de l'Est, La Revue dominicaine, Le Foyer Rural, Le Rosaire, Le Canada-Français, La Petite Feuille, La Tribune de Sherbrooke, Hérauts, La Province, La Survivance, Le Courrier de l'éducation et du progrès joumal haïtien, La Terre de Chez Nous, Le Phare, la revue Sciences et Aventures. Elle fonde la troupe de théâtre pour enfants les Aiglons de Maska en 1954 et les Editions D'Aigle en 1959, devenant ainsi l'une des premières femmes éditrices au Canada. Elle fait partie de nombreuses associations littéraires et journalistiques dont la Société des écrivains canadiens, le Cercle des femmes journalistes, la Société des poètes canadiens-français, la Société des écrivains pour la jeunesse, l'Association des auteurs dramatiques, les Jeunesses musicales du Canada, l'Académie des poètes classiques de France en 1954, ainsi que de plusieurs sociétés d'histoire. Elle publie une douzaine de volumes pour la jeunesse à sa maison d'édition : « Tourlour, histoire d'un gros ours brun », 1941, 47 p., « Les contes de Maska », 1942, 130 p., « The stories of Maska », Saint-Hyacinthe, Editions Yamaska, 1945, « Caquets Champêtres», 1946, 136 p., « Un Noël à la Canadienne » (pièce de théâtre pour les jeunes), 1952, 24 p., « Quand les animaux parlent », 1955, 136 p., « Grind'or », 1959, 51 p., « Les Noël des fleurs. Mystère de Noël en trois actes», Coll. Petites pièces D'Aigle, 1962, 58 p., « La couleur pauvre », 1963, 50 p., « L'étoile du sourire. Pièce de Noël en 1 acte», Coll. Petites pièces D'Aigle, 1963, 50 p., « Les aiglons m'ont dit », 1964, 96 p., « Trois Noëls», 1964, 64 p., « La première institutrice de Ville-Marie ». La compagnie RCA Victor endisque, le 4 décembre 1949, quatre de ses contes : « Le petit cheval gris », « Le ver de terre comédien », « Puce, ou le grand voyage d'une petite graine », « Patte noire, le moutonnet blanc ». La fin de sa vie est consacrée à la rédaction de « Histoire de Casavant Frères, 1880- 1980 », 1990, 817 p. Au cours de sa carrière, elle reçoit le lauréat de la classe 228 du Festival-concours de musique de Québec en 1938, le lauréat du concours littéraire-sonnet en 1938, une mention honorable (section magazine) du Canadian Women's Press Club en 1952, ainsi que le prix de journalisme Laure Hurteau pour la meilleure page féminine en 1956. Elle est honorée par la Ville de Saint-Hyacinthe en tant que personnalité de l'année dans la domaine Arts et Lettres en 1967. Elle donne aussi bénévolement de son temps à la Croix-Rouge et à l'Oeuvre des Orphelins. Elle décède le 16 mai 1990, à Saint-Hyacinthe.
L'École commerciale Lussier est fondée en 1935 (le 3 novembre 1936?) par Charles-Léon Lussier (1907-1974). Ancien employé du service de comptabilité de la compagnie General Steel Wares Limited de Montréal, monsieur Lussier a fait son cours classique au Séminaire de Joliette (1919-1927) puis ses études commerciales à l'École commerciale pratique Côté. De plus, il a suivi des cours de l'Université de Chicago et a enseigné trois ans à l'École Côté de Saint-Hyacinthe et de Trois-Rivières (1932-1936). Il s'est présenté comme candidat à Saint-Hyacinthe aux élections provinciales de 1944 à titre de représentant du Bloc populaire. D'abord située dans l'édifice Brodeur, à l'angle de l'avenue Saint-Denis et de la rue Des Cascades, l'école déménage bientôt au 780, avenue de l'Hôtel-Dieu (v.1946), puis au 1324, rue Des Cascades (v.1948). Dans les années 1950, elle s'installe au 1895, rue Duvernay, puis au 2 290, avenue Saint-Joseph. Durant un certain nombre d'années, des cours ont été dispensés dans des locaux au sous-sol de l'église Saint-Sacrement à Saint-Hyacinthe pour pallier au manque d'espace de la grande maison de l'avenue Saint-Joseph. Après plus de trente ans sur l'avenue Saint-Joseph, les autorités de l'école loue l'édifice des Soeurs de Sainte-Marthe laissé vacant par leur départ et leur regroupement au Séminaire même. Les élèves entrent dans leurs nouveaux locaux à partir du mois d'août 1982, au 1090, avenue Pratte. Les activités de l'école cessent en juillet 1992. L'école était située depuis une année à l'étage supérieur du magasin Croteau, angle rue Des Cascades et avenue Saint-François. Les étudiants qui la fréquentaient alors ont été intégrés à l'option secrétariat de la Commission scolaire régionale de Saint-Hyacinthe, à la suite de la décision du ministère de l'Éducation. L'École dispense le cours commercial, soit la comptabilité, l'arithmétique, la sténographie, la dactylographie, les sciences commerciales, l'informatique, le français et l'anglais. Il est intéressant de noter que cette institution privée était probablement la seule à dispenser l'enseignement de l'anglais sur une base aussi intensive. L'école a également dispensé des cours aux adultes et permettait à ses finissants et finissantes d'acquérir de l'expérience par des stages dans le milieu du travail. En 1948, l'École a décerné plus de cent certificats à 52 finissants et finissantes. En 1991-1992, 37 étudiantes y sont inscrites. L'École commerciale Lussier avait comme devise « Fais ce que dois ». Le fondateur a été nommé gouverneur de district, pour l'Est du Canada et la Nouvelle-Angleterre, de l'Association des collèges commerciaux d'Amérique (American Association of Business Colleges). Toujours en 1960, il est décoré et fait Chevalier de l'Ordre académique de la Société du bon parler français. Après son décès en 1974, l'épouse de monsieur Lussier, Rose-Armande Ménard, prend la relève et devient présidente de l'École, puis son fils Jacques Lussier, au début des années 1980. Ce dernier a eu l'initiative de créer la « Fondation Charles-Léon Lussier » afin d'aider des étudiants et étudiantes à poursuivre leurs études. En août 1984, les Lussier se retirent du conseil d'administration et permettent à de nouveaux administrateurs de poursuivre l'oeuvre d'enseignement. Les trois nouveaux membres de la corporation à but non lucratif sont : mesdames Monique Trahan, présidente, Jeanne Trahan, vice-présidente et monsieur Jean Ménard, déjà professeur à l'École, assistant-directeur depuis 1975. Ce dernier agira au poste de secrétaire-trésorier. L'École a formé plus 4 500 élèves qui ont occupé des postes dans les différents bureaux de la ville et des environs.
Vers 1892, l'abbé Charles-Philippe Choquette, professeur de sciences, ouvre un premier bureau de météorologie au Séminaire de Saint-Hyacinthe, relié au bureau central de Toronto. Cette station est composée d'une girouette et d'un anémomètre reliés à un enregistreur pour connaître la direction et la vitesse du vent, d'un baromètre enregistreur traçant la courbe des variations atmosphériques, de thermomètres minima et maxima, d'un hydromètre et d'un pluviomètre. Cette station est en activité de 1893 à 1898, par la suite Mgr Choquette poursuit les opérations pour son propre plaisir. En 1934, l'abbé François-Xavier Côté, un autre professeur de sciences, prend la relève avec des instruments fournis par le Bureau de météorologie du ministère des Richesses naturelles de Québec qui reconnaît officiellement la station météorologique du Séminaire. Deux fois par jour, à 8:00 et 18:00 heures, l'observateur recueille tous les renseignements selon le phénomène observé: orage, coup de vent, tornade, arc-en-ciel, pluie, neige, verglas, grésil, brume, brouillard, montée de la sève, éclatement des bourgeons, etc. Chaque lundi, ces renseignements sont envoyés au ministère des Ressources naturelles (section météorologie), aux journaux Le Courrier et Le Clairon de Saint-Hyacinthe. Chaque mois, un rapport plus détaillé indique les températures minimales et maximales du mois, la quantité de précipitation tombée durant le mois et tout autre phénomène intéressant. Chaque année, un inspecteur du gouvernement vient vérifier l'état des instruments et faire les ajustements nécessaires. En l'absence de l'abbé Côté, c'est le portier du Séminaire qui fait la lecture des instruments (Léo Saint-Laurent à partir de 1948). En 1955, à la suite du décès de l'abbé Côté, l'abbé Georges-Albert Lanciault devient le responsable de la station, toujours assisté de M. Saint-Laurent. En 1966, Léo Saint-Laurent devient l'observateur en titre, il quitte ce poste en 1979 à cause de problèmes de santé ce qui met fin aux opérations de la station météorologique du Séminaire.
La municipalité du Village Saint-Joseph est fondée en 1898 et fusionnée à la ville de Saint-Hyacinthe en 1976. En 1916, une demande est adressée aux autorités religieuses pour la construction d'une église et la création d'une paroisse. En avril 1921, un premier curé est nommé, l'abbé Hugues Lafontaine et l'érection canonique est rédigée en 1922. Pendant près de trente ans, les offices religieux seront célébrés dans un local considéré comme devant être le sous-sol de la future église. La première messe y est célébrée le 25 décembre 1921. Malheureusement, avec les années, ce bâtiment devient insuffisant et il est décidé de construire une nouvelle église en 1953. Une chapelle temporaire est alors aménagée dans une salle de l'école Roméo Forbes. La bénédiction de la pierre angulaire a lieu le 9 mai 19.54 et l'église ouvre à l'été. Pour sa part le presbytère est agrandi en 1963.
Les 1er et 2 octobre 1924, 2 400 cultivateurs dont 1 000 sont délégués officiels de leur paroisse, participent au congrès de la fondation de l'UCC (Union catholique des cultivateurs) à Québec. Les premières résolutions du syndicalisme agricole portent sur les thèmes suivants : l'enseignement agricole, le crédit agricole, le commerce des produits agricoles, la colonisation, la voirie, la coopération, les taux du transport ferroviaire des produits agricoles. Le nombre de membres s'élève à 20·000 en 1941. Afin de faire la promotion du milieu agricole, l'UCC publie des brochures et fonde La Terre de chez nous en 1929. L'UCC devient l'Union des Producteurs agricoles (UPA) en 1972 avec la Loi des Producteurs agricoles, pour mieux rendre compte des changements profonds dans le domaine et se soustraire à toute juridiction religieuse. L'UPA compte 43 368 membres en 1994. La section de Saint-Hyacinthe de l'UCC est fondée en 1931 et le premier président est Alexis Beauregard, de Sainte-Hélène. Cette organisation porte plusieurs noms à travers les époques. D’abord reconnue sous le nom de l’Union diocésaine de l’UCC de Saint-Hyacinthe, elle devient la Fédération de l’UCC de Saint-Hyacinthe le 13 juin 1946. Elle couvre alors le même territoire qu’avant, soit celui du diocèse de Saint-Hyacinthe, ce qui inclus les paroisses des circonscriptions de Saint-Hyacinthe, Bagot, Richelieu, Rouville, Iberville, Missisquoi et quelques paroisses des circonscriptions de Verchères, Shefford et Brome. En 1972, l’organisation change à nouveau de nom et devient la Fédération de l’Union des producteurs agricoles de Saint-Hyacinthe.
Le défrichement du sol de la future paroisse débute sous la régence de Jean-Baptiste Hertel vers 1730. C'est cependant sous l'administration de M. Jean-Baptiste Melchior de Rouville, vers 1780, que la colonisation se fait plus intense. Les pionniers viennent surtout de Chambly, Beloeil, Verchères, Contrecoeur et Varennes. Vers 1795, l'évêque de Québec accepte la création de la nouvelle paroisse qui se détache de Beloeil et Saint-Mathias. Messire Jean-Baptiste Bédard, vicaire à la cathédrale de Québec, en est le premier curé en avril 1797. Une chapelle est érigée en haut du presbytère (la première messe y est célébrée le jour 9e la Toussaint 1797) et celle-ci sert pour le culte jusqu'en 1810. L'église actuelle est
construite en 1807. A cette époque, la paroisse compte environ 2 000 runes, pour une superficie de 17 000 arpents et comprend le territoire de Saint-Hilaire et une bonne partie de Saint-Damase et Sainte-Madeleine. La maçonnerie est confiée à Pierre Ménard dit Belle-Rose, la menuiserie à Sébastien Fleurant et la décoration à M. Quevillon, maître sculpteur de Saint-Vincent-de-Paul (c'est aussi lui qui a fait le maître-autel). La chaire est !'oeuvre de M. Vincent Chartrand, également de Saint-Vincent-de-Paul et sculpteur renommé.