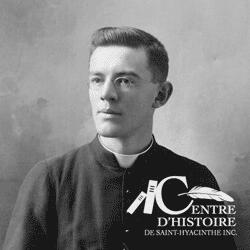
Zone du titre et de la mention de responsabilité
Titre propre
Dénomination générale des documents
Titre parallèle
Compléments du titre
Mentions de responsabilité du titre
Notes du titre
- Source du titre propre: Titre composé propre basé sur le créateur du fonds.
Niveau de description
Cote
Zone de l'édition
Mention d'édition
Mentions de responsabilité relatives à l'édition
Zone des précisions relatives à la catégorie de documents
Mention d'échelle (cartographique)
Mention de projection (cartographique)
Mention des coordonnées (cartographiques)
Mention d'échelle (architecturale)
Juridiction responsable et dénomination (philatélique)
Zone des dates de production
Date(s)
-
1823-[1988] (Création/Production)
- Producteur
- Mgr Émile Chartier
Zone de description matérielle
Description matérielle
2,10 m de documents textuels. – 142 documents photographiques. – 293 documents iconographiques.
Zone de la collection
Titre propre de la collection
Titres parallèles de la collection
Compléments du titre de la collection
Mention de responsabilité relative à la collection
Numérotation à l'intérieur de la collection
Note sur la collection
Zone de la description archivistique
Nom du producteur
Notice biographique
Émile Chartier est né à Sherbrooke le 18 juin 1876. Fils d'Étienne Chartier, avocat, et d'Henriette Blondin, il grandira au presbytère de Sainte-Madeleine avec ses deux oncles Jean-Baptiste et Victor Chartier. Il fait ses études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe de 1886 à 1894. Durant ses quatre années d'études théologiques à Saint-Hyacinthe, il enseigne le grec et l'anglais au Séminaire. Le 28 mai 1899, il est ordonné prêtre à Sainte-Madeleine, par Mgr Maxime Decelles. Assigné au Séminaire à titre de professeur jusqu'en 1903, il se rend étudier en Europe jusqu’en 1907. À l'Université de La Propagande à Rome, il obtient un doctorat en philosophie et à l'Université Grégorienne, un doctorat en théologie. Il étudie aussi à la Sorbonne où il se voit décerner une licence ès lettres. Revenu enseigner au Séminaire de Saint-Hyacinthe, il est recruté en 1914 par Mgr Paul Bruchési pour occuper le poste de secrétaire général et de professeur à l'Université Laval de Montréal. À la naissance de l'Université de Montréal, il fonde la Faculté des Lettres de cette institution et sera nommé vice-recteur de 1920 à 1944. Durant cette période, il donne de nombreuses conférences autant en français qu’en anglais et plusieurs titres lui sont attribués : chanoine en 1918, prélat domestique en 1939, docteur en philosophie de l'Université McGill et en lettres de l'Université Queen's. Il est un des précurseurs de l’Association catholique de la jeunesse canadienne-française, membre de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, de la Société royale du Canada, de la Société du parler français au Canada, de la Société historique de Montréal, de la Société des études grecques de France et de plusieurs autres associations. Il sera même invité à donner des cours à l'Institut catholique et à la Sorbonne à Paris. Collaborateur à plusieurs revues et journaux dont Le Pionnier de Sherbrooke et La Vérité, il publie entre autres à titre d’auteur «Pages de combat» (1911), «L'Art de l'expression littéraire» (1916), «Le Canada français» (1922), «Bréviaire du patriote canadien-français» (1925), «La vie de l’esprit» (1941) et «Poésie grecque» (1947). Il sera également directeur de plusieurs périodiques dont «La Revue canadienne», et un des directeurs de «L’Encyclopédie de la jeunesse» et collaborateur pour «Pays et nations», en plus d’être réviseur linguistique pour des projets d’écriture de d’autres auteurs. Il prend officiellement sa retraite en 1944 et déménage à Sherbrooke, où il continue à offrir son expertise et collabore à la fondation de l’Université. Il décède à Sherbrooke le 27 février 1963.
Historique de la conservation
Portée et contenu
Ce fonds témoigne de la multitude de responsabilités et de dossiers qui intéressent Émile Chartier à tout ce qui touche la littérature, la religion, les langues et surtout la jeunesse qui a besoin d’être éduquée pour former une société forte et instruite. Émile Chartier établit des contacts partout où il passe et communique avec plusieurs personnalités importantes de la société canadienne. D’ailleurs, la volumineuse correspondance que contient ce fonds d’archives témoigne de la vitalité de ses relations, mais également de son intérêt pour garder les traces tangibles des conversations puisqu’il demande à ses destinataires de conserver leur correspondance, ce qui aura comme résultante que dans certains cas, le fonds contient autant la correspondance reçue que celle qu’il avait envoyée à ses interlocuteurs. On retrouve des échanges avec plusieurs membres de sa famille dont son père Étienne Chartier, son oncle l’abbé Victor Chartier; des amis et collègues de classe; de nombreux échanges de correspondance durant son séjour d’études de quatre ans en Europe; ses confrères de travail et ses anciens élèves au Séminaire de Saint-Hyacinthe; ses confrères de travail, ses anciens élèves et ses nombreux contacts durant sa longue carrière à l’Université Laval puis à l’Université de Montréal dont Mgr Paul Bruchési; et des personnages-clés de son implication sociale et littéraire, tels l’abbé Lionel Groulx, Olivar Asselin et Jules-Paul Tardivel. On trouve aussi des dossiers de recherches personnelles, dont un dossier sur l’abbé Étienne Chartier; des sermons; des dossiers sur ses implications sociales, telles l’Association catholique pour la jeunesse canadienne-française et la Société royale du Canada, ainsi que de nombreux autres organismes à caractère social et éducationnel; les textes des nombreuses conférences données par Émile Chartier durant sa carrière à l’Université de Montréal, touchant surtout des sujets à caractère social, tels la religion, l’éducation, les relations de travail et particulièrement sur les relations entre francophones et anglophones du Québec et de l’Ontario et sur les méthodes d’enseignement. Finalement, on retrouve des dossiers relatifs à sa production littéraire, soit une dizaine de monographies; également comme directeur de revue, collaborateur journalistique; compositeur (chansons et poésies); et des collaborations à des encyclopédies et à titre de réviseur. Les photographies nous montrent Émile Chartier dans différentes circonstances, lors de ses voyages en Europe, en compagnie de collègues dont Mgr Paul Bruchési à LaFlèche et le Père Jérôme en Angleterre, ainsi que des membres de la famille Chartier, dont les frères Jean-Baptiste, Victor et Ferrier. Les documents iconographiques sont composés de cartes postales envoyées et reçues par Émile Chartier, dont plusieurs d’Europe, mais également une collection d’images de la Première Guerre mondiale.
Zone des notes
État de conservation
Source immédiate d'acquisition
Ce fonds appartient aux archives du Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe qui l'a reçu de la succession de Mgr Émile Chartier.
Classement
Langue des documents
Écriture des documents
Localisation des originaux
Disponibilité d'autres formats
Restrictions d'accès
Délais d'utilisation, de reproduction et de publication
Instruments de recherche
Instrument de recherche téléversé
Éléments associés
Bibliothèques et Archives nationales du Québec (BAnQ), ainsi que les Universités de Montréal, Sherbrooke et Ottawa possèdent également un fonds Mgr Émile Chartier.
Accroissements
Identifiant(s) alternatif(s)
Ancienne cote
Numéro normalisé
Numéro normalisé
Mots-clés
Mots-clés - Lieux
Mots-clés - Noms
Mots-clés - Genre
Zone du contrôle
Identifiant de la description du document
Identifiant du service d'archives
Règles ou conventions
Statut
Niveau de détail
Dates de production, de révision et de suppression
Langue de la description
Langage d'écriture de la description
Sources
- « Mgr Émile Chartier » dans Annuaire du Séminaire de Saint-Hyacinthe, année scolaire 1962-1963, n° 85. pp. 78-82.
- « Mgr Émile Chartier » dans DION, Jean-Noël et al. Saint-Hyacinthe, des vies, des siècles, une histoire. Saint-Hyacinthe, Club des Moose, 1983. pp. 191-193.
- « Émile Chartier (1876-1963) » dans HAMEL, Réginald et al. Dictionnaire pratique des auteurs québécois. Montréal, Fides, 1976. pp. 132-133.
