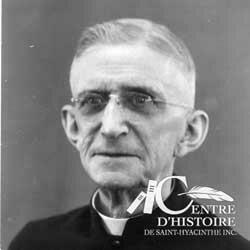Ce fonds témoigne de la multitude de responsabilités et de dossiers qui intéressent Émile Chartier à tout ce qui touche la littérature, la religion, les langues et surtout la jeunesse qui a besoin d’être éduquée pour former une société forte et instruite. Émile Chartier établit des contacts partout où il passe et communique avec plusieurs personnalités importantes de la société canadienne. D’ailleurs, la volumineuse correspondance que contient ce fonds d’archives témoigne de la vitalité de ses relations, mais également de son intérêt pour garder les traces tangibles des conversations puisqu’il demande à ses destinataires de conserver leur correspondance, ce qui aura comme résultante que dans certains cas, le fonds contient autant la correspondance reçue que celle qu’il avait envoyée à ses interlocuteurs. On retrouve des échanges avec plusieurs membres de sa famille dont son père Étienne Chartier, son oncle l’abbé Victor Chartier; des amis et collègues de classe; de nombreux échanges de correspondance durant son séjour d’études de quatre ans en Europe; ses confrères de travail et ses anciens élèves au Séminaire de Saint-Hyacinthe; ses confrères de travail, ses anciens élèves et ses nombreux contacts durant sa longue carrière à l’Université Laval puis à l’Université de Montréal dont Mgr Paul Bruchési; et des personnages-clés de son implication sociale et littéraire, tels l’abbé Lionel Groulx, Olivar Asselin et Jules-Paul Tardivel. On trouve aussi des dossiers de recherches personnelles, dont un dossier sur l’abbé Étienne Chartier; des sermons; des dossiers sur ses implications sociales, telles l’Association catholique pour la jeunesse canadienne-française et la Société royale du Canada, ainsi que de nombreux autres organismes à caractère social et éducationnel; les textes des nombreuses conférences données par Émile Chartier durant sa carrière à l’Université de Montréal, touchant surtout des sujets à caractère social, tels la religion, l’éducation, les relations de travail et particulièrement sur les relations entre francophones et anglophones du Québec et de l’Ontario et sur les méthodes d’enseignement. Finalement, on retrouve des dossiers relatifs à sa production littéraire, soit une dizaine de monographies; également comme directeur de revue, collaborateur journalistique; compositeur (chansons et poésies); et des collaborations à des encyclopédies et à titre de réviseur. Les photographies nous montrent Émile Chartier dans différentes circonstances, lors de ses voyages en Europe, en compagnie de collègues dont Mgr Paul Bruchési à LaFlèche et le Père Jérôme en Angleterre, ainsi que des membres de la famille Chartier, dont les frères Jean-Baptiste, Victor et Ferrier. Les documents iconographiques sont composés de cartes postales envoyées et reçues par Émile Chartier, dont plusieurs d’Europe, mais également une collection d’images de la Première Guerre mondiale.
Mgr Émile ChartierSainte-Madeleine
2 Description archivistique résultats pour Sainte-Madeleine
Ce fonds témoigne de la vie sacerdotale de l’abbé Gilbert Spénard. Il comprend deux extraits de registre datant de 1906, l’un reproduisant l’acte de baptême de l’abbé Spénard et l’autre sa confirmation qui a eu lieu à l’église Notre-Dame du Rosaire à Saint-Hyacinthe en 1898; une carte postale datée de février 1925 envoyée de Rome à l’abbé Spénard par sa tante maternelle Clara Chabot; un signet mortuaire de l’abbé Spénard; un ferrotype montrant un couple (possiblement les parents de l’abbé Spénard); une carte postale montrant l’église de Fabre en construction envoyée à l’abbé Spénard par son cousin Ernest Lemieux; une photographie du presbytère de Fabre avec quatre personnes dont l’abbé Spénard; une photographie de l’abbé Spénard à l’intérieur du presbytère de Fabre; une photographie de l’abbé Spénard avec trois femmes et deux hommes non identifiés; une photographie de l’abbé Spénard et d’une dame âgée (possiblement sa mère).
abbé Gilbert Spénard